07 mai 2018
Marx dans le texte (10)

Les ouvriers de Paris ont été écrasés par des forces supérieures; ils n'ont pas succombé. Ils sont battus mais leurs adversaires sont vaincus. Le triomphe momentané de la force brutale est payé par l'anéantissement de toutes les illusions et chimères de la révolution de février, par la désagrégation de tout le parti des vieux républicains, par la scission de la nation française en deux nations, la nation des possédants et la nation des travailleurs. La république tricolore n'arbore plus qu'une seule couleur, la couleur des vaincus, la couleur du sang, elle est devenue la république rouge.
Aux côtés du peuple, aucune voix réputée républicaine, ni du National [1] ni de La Réforme [2] ! Sans autres chefs, sans autres moyens que l'indignation elle-même, il a résisté à la bourgeoisie et à la soldatesque coalisées plus longtemps qu'aucune dynastie française, pourvue de tout l'appareil militaire, ne résista à une fraction de la bourgeoisie coalisée avec le peuple. Pour faire disparaître la dernière illusion du peuple, pour rompre complètement avec le passé, il fallait aussi que les auxiliaires habituels et poétiques de l'émeute française, la jeunesse bourgeoise enthousiaste, les élèves de l'École polytechnique, les tricornes fussent du côté des oppresseurs. Il fallait que les élèves de la Faculté de médecine refusent aux plébéiens blessés le secours de la science. La science n'est pas là pour le plébéien qui a commis l'indicible, l'inexprimable crime de tout risquer pour sa propre existence, et non pour Louis-Philippe ou M. Marrast.
Le dernier vestige officiel de la révolution de février, la Commission exécutive [3], s'est évanouie, comme la brume, devant la gravité des événements. Les feux d'artifice de Lamartine se sont transformés en fusées incendiaires de Cavaignac.
La fraternité, cette fraternité des classes opposées dont l'une exploite l'autre, cette fraternité proclamée en février, écrite en majuscules, sur le front de Paris, sur chaque prison, sur chaque caserne - son expression véritable, authentique, prosaïque, c'est la guerre civile, la guerre civile sous sa forme la plus effroyable, la guerre du travail et du capital. Cette fraternité a flambé devant toutes les fenêtres de Paris le soir du 25 juin, alors que le Paris de la bourgeoisie illuminait, tandis que le Paris du prolétariat brûlait, saignait, gémissait jusqu'à l'épuisement.
La fraternité a duré juste le temps que l'intérêt de la bourgeoisie a été frère de l'intérêt du prolétariat. Des pédants de la vieille tradition révolutionnaire de 1793, des socialistes à l'esprit de système qui mendiaient pour le peuple auprès de la bourgeoisie et qui furent autorisés à tenir de longs sermons et à se compromettre aussi longtemps que le lion prolétarien avait besoin d'être endormi par des berceuses, des républicains qui réclamaient intégralement le vieil ordre bourgeois mais sans tête couronnée, des opposant dynastiques [4] pour qui le hasard avait substitué la chute de la dynastie à un changement de ministre, des légitimistes [5] qui voulaient non pas dépouiller la livrée mais en modifier la coupe, voilà les alliés avec qui le peuple fit février. Ce que d'instinct il haïssait en Louis-Philippe, ce n'était pas Louis-Philippe, c'était la domination couronnée d'une classe, c'était le capital sur le trône. Mais, magnanime comme toujours, il crut avoir anéanti son ennemi après avoir renversé l'ennemi de ses ennemis, l'ennemi commun.
La révolution de février fut la belle révolution, la révolution de la sympathie générale, parce que les contradictions (entre la bourgeoisie et le peuple) qui éclatèrent en elle contre la royauté, n'étaient pas encore développées et demeuraient en sommeil, unies, côte à côte, parce que la lutte sociale qui formait l'arrière-plan de cette révolution, n'avait atteint qu'une existence inconsistante, une existence purement verbale. La révolution de juin est laide; c'est la révolution repoussante, parce que la réalité a pris la place des mots, parce que la République a démasqué la tête même du monstre en lui arrachant la couronne qui la protégeait et la cachait.
L'Ordre ! tel fut le cri de guerre de Guizot. L'Ordre ! cria Sébastiani le guizotin, quand Varsovie devint russe. L'Ordre ! crie Cavaignac, écho brutal de l'Assemblée nationale française et de la bourgeoisie républicaine. L'Ordre ! gronda sa mitraille en déchirant le corps du prolétariat.
Aucune des nombreuses révolutions de la bourgeoisie française depuis 1789 n'était un attentat contre l'Ordre, car toutes laissaient subsister la domination de classe, l'esclavage des ouvriers, l'ordre bourgeois, malgré le changement fréquent de la forme politique de cette domination et de cet esclavage. Juin a touché à cet ordre. Malheur à juin !
Sous le gouvernement provisoire, on fit imprimer sur des milliers d'affiches officielles que les ouvriers au grand cœur « mettaient trois mois de misère à la disposition de la République »; il était donc décent, mieux : nécessaire, c'était à la fois de la politique et de la sentimentalité, de leur prêcher que la révolution de février avait été faite dans leur propre intérêt et que, dans cette révolution, il s'agissait avant tout des intérêts des ouvriers. Depuis que siégeait l'Assemblée nationale - on devenait prosaïque. Il ne s'agissait plus alors que de ramener le travail à ses anciennes conditions, comme le disait le ministre Trélat. Les ouvriers s'étaient donc battus en février pour être jetés dans une crise industrielle.
La besogne de l'Assemblée nationale consiste à faire en sorte que février n'ait pas existé, tout au moins pour les ouvriers qu'il s'agit de replonger dans leur ancienne condition. Et même cela ne s'est pas réalisé, car une assemblée, pas plus qu'un roi, n'a le pouvoir de dire à une crise industrielle de caractère universel : Halte-là ! L'Assemblée nationale, dans son désir zélé et brutal d'en finir avec les irritantes formules de février, ne prit même pas les mesures qui étaient encore possibles dans le cadre de l'ancien état de choses. Les ouvriers parisiens de 17 à 25 ans, elle les enrôle de force dans l'armée ou les jette sur le pavé; les provinciaux, elle les renvoie de Paris en Sologne, sans même leur donner avec le laisser-passer l'argent du voyage; aux Parisiens adultes, elle assure provisoirement de quoi ne pas mourir de faim dans des ateliers organisés militairement, à condition qu'ils ne participent à aucune réunion populaire, c'est-à-dire à condition qu'ils cessent d'être des républicains. La rhétorique sentimentale d'après février ne suffisait pas, la législation brutale d'après le 15 mai [6] non plus. Dans les faits, en pratique, il fallait trancher. Avez-vous fait, canailles, la révolution de février pour vous ou bien pour nous ? La bourgeoisie posa la question de telle façon, qu'il devait y être répondu en juin - avec des balles et par des barricades.
Et pourtant, ainsi que le dit le 25 juin un représentant du peuple, la stupeur frappe l'Assemblée nationale tout entière. Elle est abasourdie quand question et réponse noient dans le sang le pavé de Paris; les uns sont abasourdis parce que leurs illusions s'évanouissent dans la fumée de la poudre, les autres parce qu'ils ne saisissent pas comment le peuple peut oser prendre lui-même en main la défense de ses intérêts les plus personnels. Pour rendre cet événement étrange accessible à leur entendement, ils l'expliquent par l'argent russe, l'argent anglais, l'aigle bonapartiste, le lys et des amulettes de toutes sortes. Mais les deux fractions de l'Assemblée sentent qu'un immense abîme les sépare toutes deux du peuple. Aucune n'ose prendre le parti du peuple.
À peine la stupeur passée, la furie éclate, et c'est à juste titre que la majorité siffle ces misérables utopistes et tartufes qui commettent un anachronisme en ayant toujours à la bouche ce grand mot de Fraternité. Il s'agissait bien en effet de supprimer ce grand mot et les illusions que recèlent ses multiples sens. Lorsque Larochejaquelein, le légitimiste, le rêveur chevaleresque, fulmine contre l'infamie qui consiste à crier « Vae victis ! Malheur aux vaincus ! [7] » la majorité de l'Assemblée est prise de la danse de Saint-Guy comme si la tarentule l'avait mordue. Elle crie : Malheur ! aux ouvriers pour dissimuler que le « vaincu » c'est elle. Ou bien c'est elle qui doit maintenant disparaître, ou c'est la République. C'est pourquoi elle hurle convulsivement : Vive la République !
Le gouffre profond qui s'est ouvert à nos pieds, peut-il égarer les démocrates, peut-il nous faire accroire que les luttes pour la forme de l'État sont vides, illusoires, nulles ?
Seuls des esprits faibles et lâches peuvent soulever pareille question. Les conflits qui naissent des conditions de la société bourgeoise elle-même, il faut les mener jusqu'au bout; on ne peut les éliminer en imagination. La meilleure forme d'État est celle où les contradictions sociales ne sont pas estompées, ne sont pas jugulées par la force, c'est-à-dire artificiellement et donc en apparence seulement. La meilleure forme de gouvernement est celle où ces contradictions entrent en lutte ouverte, et trouvent ainsi leur solution.
On nous demandera si nous n'avons pas une larme, pas un soupir, pas un mot pour les victimes de la fureur du peuple, pour la garde nationale, la garde mobile, la garde républicaine, les troupes de ligne ?
L'État prendra soin de leurs veuves et de leurs orphelins, des décrets les glorifieront, de solennels cortèges funèbres conduiront leurs dépouilles à leur dernière demeure, la presse officielle les déclarera immortels, la réaction européenne leur rendra hommage, de l'Est à l'Ouest.
Quant aux plébéiens, déchirés par la faim, vilipendés par la presse, abandonnés par les médecins, traités par les « gens bien » de voleurs, d'incendiaires, de galériens, leurs femmes et leurs enfants précipités dans une misère encore plus incommensurable, les meilleurs des survivants déportés outre-mer, c'est le privilège, c'est le droit de la presse démocratique de tresser des lauriers sur leur front assombri de menaces.
Notes
[1] Journal fondé le 3 janvier 1830 par Thiers, Mignet, Carrel et Sautelet. Au début son mot d'ordre inspiré par Thiers était d'« enfermer les Bourbons dans la Charte ». Ce journal attaqua vigoureusement le ministère Polignac. Après la révolution de Juillet il soutint le gouvernement de Louis-Philippe, puis lui fit une vive opposition à partir de 1832. À la mort de Carrel, Le National devint républicain avec Marrast qui en fut rédacteur en chef jusqu'en 1848. Le National fut supprimé après le coup d'État de 1851.
[2] Journal de Ledru-Rollin.
[3] La Commission exécutive : gouvernement de la République française créé le 10 mai 1848 par l'Assemblée constituante. Elle remplaça le gouvernement provisoire. Elle exista jusqu'au 24 juin, date où s'instaura la dictature de Cavaignac.
[4] Groupes de députés dirigés par Odilon Barrot qui, sous la monarchie de Juillet, représentaient une tendance modérée de la gauche. Exprimant les concertions des cercles libéraux de la bourgeoisie industrielle et commerçante, ils prirent parti pour une réforme électorale modérée dans laquelle ils voyaient un moyen d'éviter la révolution et de maintenir la dynastie des Orléans. Ils furent les promoteurs de cette Campagne des banquets qui, contrairement à leurs prévisions, aboutit non à une réforme mais à une révolution.
[5] Les légitimistes étaient des partisans de la dynastie « légitime » des Bourbons. Ils représentaient les intérêts de la noblesse terrienne et des grands propriétaires fonciers.
[6] Aucun membre de la Commission exécutive, aucun ministre n'est socialiste; cette exclusion indigne la minorité de gauche qu'exaspèrent le refus de créer un ministère du Travail et l'interdiction de présenter directement des pétitions (12 mai). Ce mécontentement est à l'origine de la journée du 15 mai, pour la plus grande part. En principe, il s'agit d'une manifestation pacifique qui doit porter à l'Assemblée une pétition en faveur de la Pologne. Mais l'obscur travail de certains meneurs (peut-être provocateurs, comme le douteux Huber), les défaillances du service d'ordre et de son chef, le général Courtais, la font très vite dévier. L'Assemblée est envahie, et dans une extrême confusion un nouveau gouvernement provisoire tente de s'organiser. Lamartine et Ledru-Rollin, regroupant les fractions de la Garde nationale, arrivent dans la soirée à rétablir l'ordre, en évitant toute effusion de sang.
Cette journée est « plus qu'une faute politique une faute morale » (George Sand). Elle est sévèrement jugée par une opinion provinciale soucieuse de légalité; elle provoque des arrestations et des poursuites devant la Haute-Cour de Bourges, qui commencent la désorganisation des cadres de gauche (Barbès, Raspail, Blanqui, l'ouvrier Albert sont arrêtés.) Elle motive la suppression de la Commission du Luxembourg (16 mai) et permet la fermeture des clubs les plus avancés. (E. Tersen : Histoire contemporaine (1848-1939).
[7] Cri poussé par Brennus lors de la prise de Rome par les Gaulois.
[Karl Marx , La révolution de juin, La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 29, 29 juin 1848]
Revenons enfin à la Belgique, à notre État constitutionnel « modèle », à l'Eldorado monarchique à base démocratique la plus large, à l'école supérieure des Berlinois diplômés ès arts politiques, à la fierté de la Kölnische Zeitung.
Considérons d'abord la situation économique dont la fameuse Constitution politique ne forme que le cadre doré.
Le Moniteur [1] belge - la Belgique a son Moniteur - donne les nouvelles suivantes du plus grand vassal de Léopold, le paupérisme.
On trouve :
|
dans la province de Luxembourg |
1 habitant secouru sur 69; |
|
dans celle de Namur |
1 habitant secouru sur 17; |
|
dans celle d'Anvers |
1 habitant secouru sur 16; |
|
dans celle de Liège |
1 habitant secouru sur 7; |
|
dans celle de Limbourg |
1 habitant secouru sur 7; |
|
dans celle de Hainaut |
1 habitant secouru sur 6; |
|
dans celles des Flandres orientales |
1 habitant secouru sur 5; |
|
dans celle de Brabant |
1 habitant secouru sur 4; |
|
dans celle des Flandres occidentales |
1 habitant secouru sur 3. |
Cet accroissement du paupérisme va entraîner nécessairement un nouvel accroissement du paupérisme. Avec l'impôt de solidarité que leur imposent leurs concitoyens paupérisés, tous les individus ayant les moyens de mener une existence indépendante perdent leur stabilité bourgeoise et sont également précipités dans le gouffre de la bienfaisance publique. Le paupérisme engendre donc avec une vitesse accrue le paupérisme. Mais à mesure que le paupérisme augmente, la criminalité augmente aussi, et la jeunesse, la source vitale par excellence de la nation, est démoralisée.
Les années 1845, 1846, 1847 nous apportent à cet égard de tristes documents [2].
Nombre des jeunes gens et jeunes filles de moins de 18 ans détenus par décision du tribunal :
|
|
1845 |
1846 |
1847 |
|
Jeunes gens |
2,146 |
4,607 |
7,283 |
|
Jeunes filles |
429 |
1,279 |
2,069 |
|
Total |
2,575 |
5,886 |
9,352 |
|
Total général |
17,813 |
||
Donc, à partir de 1815, le nombre des délinquants juvéniles de moins de 18 ans, a environ doublé chaque année. À ce rythme, en 1850, la Belgique compterait 74.816 délinquants juvéniles, et en 1855 : 2.393.312, c'est-à-dire plus qu'elle n'a de jeunes de moins de 18 ans, et plus de la moitié de sa population. En 1856 toute la Belgique serait en prison, y compris les enfants à naître. La monarchie peut-elle souhaiter une base démocratique plus large ? Au cachot règne l'égalité.
Les routiniers de l'économie nationale ont en vain appliqué les deux pilules de Morrison [3], le libre-échange d'une part, la protection douanière d'autre part. Le paupérisme en Flandres est né sous le système du libre-échange, il a grandi et a forci sous les droits protectionnistes sur le lin et les toiles d'importation.
Pendant que paupérisme et criminalité croissent ainsi dans le prolétariat, les sources de revenu de la bourgeoisie tarissent comme le prouve la publication récente d'un tableau comparatif du commerce extérieur belge pendant le premier semestre des années 1846, 1847, 1848.
Mises à part les fabriques d'armes et de clous exceptionnellement favorisées par la conjoncture, les fabriques de drap qui maintiennent leur ancienne renommée, et la fabrication du zinc qui par comparaison avec l'ensemble de la production est insignifiante, toute l'industrie belge se trouve en état de déclin on de stagnation.
À peu d'exceptions près, on note une diminution considérable de l'exportation des produits des mines belges et de la métallurgie.
Citons quelques exemples :
|
|
1er semestre 1847 |
1er semestre 1848 |
|
Charbon en tonnes |
869.000 |
549.000 |
|
Fonte |
56.000 |
3.5.000 |
|
Articles en fonte |
463 |
172 |
|
Fer, rails de chemins de fer |
3.489 |
13 |
|
Fer forgé manufacturé |
556 |
434 |
|
Serrures |
3.210 |
3.618 |
|
Total général : |
932.718 |
588.237 |
Donc, la diminution totale subie par ces trois articles se monte, pour le premier semestre de 1848, à 344.481 tonnes, soit un peu plus d'un tiers.
Venons-en à l'industrie linière.
|
|
1er semestre 1846 |
1er semestre 1847 |
1er semestre 1848 |
|
Filés de lin |
1.017.000 |
623.000 |
306.000 |
|
Tissus de lin |
1.483.000 |
1.230.000 |
631.000 |
|
Total général |
2.500.000 |
1.853.000 |
987.000 |
Par rapport au semestre de 1846, celui de 1847 accuse une diminution de 657.000 kg et celui de 1848 de 1.613.000 kg ou 64 % [4].
L'exportation de livres, cristaux et verres à vitres a énormément diminué; baisse également sur l'exportation de lin brut et cardé, d'étoupe, d'écorce, de tabac manufacturé.
Le paupérisme qui s'étend, l'emprise inouïe que le crime exerce sur la jeunesse, le déclin systématique de l'industrie belge constituent la base matérielle des réjouissances constitutionnelles : le journal ministériel L'Indépendance compte, - il ne se lasse pas de le proclamer - 4.000 abonnés. Le vieux Mellinet, le seul général qui ait sauvé l'honneur belge, est aux arrêts et comparaîtra dans quelques jours devant les Assises à Anvers. L'avocat gantois Rolin qui a conspiré contre Léopold au profit de la famille d'Orange, et au profit de Léopold de Cobourg contre ses alliés ultérieurs, les libéraux belges, Rolin, deux fois apostat, a obtenu le portefeuille des Travaux publics. L'ex-brocanteur franquillon [5], baron et ministre de la Guerre Cha-a-azal brandit son grand sabre et sauve l'équilibre européen. L'Observateur a enrichi le programme des fêtes de septembre [6] d'une réjouissance nouvelle : une procession - un Ommeganck [7]général - en l'honneur du Doudou de Mons [8] , du Houplala d'Anvers [9] et du Mannequin Pisse [10] de Bruxelles. Voilà le profond sérieux de L'Observateur, le journal du grand Verhaegen. Finalement la Belgique s'est élevée au rang d'école supérieure des Montesquieu de Berlin, d'un Stupp, d'un Grimm, d'un Hansemann, d'un Baumstark et elle jouit de l'admiration de la Kölitische Zeitung. Heureuse Belgique !
Notes
[1] Le Moniteur belge, c'est ainsi que s'appelait d'après le titre de l'organe officiel du gouvernement français, un journal officiel belge, fondé à Bruxelles en 1831.
[2] Les indications suivantes sur la criminalité juvénile en Belgique sont empruntées au mémoire d'Édouard Duepetiaux paru en 1848 à Bruxelles et intitulé : Mémoire sur l'organisation des écoles de réforme.
[4] Les indications concernant l'exportation belge sont empruntées au Moniteur belge, numéro 213 du 31 juillet 1848.
[8] Personnage très populaire dans le Borinage. C'est le méchant dragon terrassé par saint Georges. C'est aussi le nom de la procession annuelle et des réjouissances qui rappellent ce haut-fait. C'est encore un chant wallon qui commence par ces mots : « Nous irons vir l'car d'or ... ! (Nous irons voir le char doré). Cette procession porte en effet officiellement le nom de procession du car d'or. C'est enfin une statuette en bronze enfermée toute l'année jusqu'à la procession annuelle.
[9] Lorsque les Espagnols furent chassés des Flandres, la population anversoise réussit à mettre la main sur le dernier soldat ennemi et le berna en l'envoyant en l'air à de nombreuses reprises dans un drap tendu brutalement à chaque fois. Alors les Anversois criaient : « Op ! Sin-jorken ! » (op ! : en l'air; sinjor : senor prononcé à la flamande; ken : suffixe diminutif marquant le mépris.) L'« Op Sinjorken » est resté un des personnages principaux du folklore anversois. Aujourd'hui encore, la kermesse d'Anvers comporte une brimade symbolique dans laquelle le « Sinjorken » est remplacé par une poupée. Lorsquon lance la poupée, les participants crient : « Houp-la-la ! Houp-la-la ! »
[10] Nous avons respecté l'orthographe de Marx. Cette statue, emblème de Bruxelles, est d'ordinaire désignée sous le nom de Manneken Pis.
[Karl Marx, La Belgique, "État modèle", La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 68, 7 août 1848]
Enfin, après les défaites presqu' ininterrompues de la démocratie depuis six mois, après une série de triomphes les plus inouïs de la contre-révolution, se manifestent enfin pour le parti révolutionnaire les symptômes d'une victoire prochaine. L'Italie, le pays dont le soulèvement a constitué le prélude au soulèvement européen de 1848, dont l'effondrement a été le prélude à la chute de Vienne, l'Italie se soulève pour la seconde fois. La Toscane a imposé son ministère démocratique et Rome vient de conquérir le sien.
Londres, 10 avril; Paris, 15 mai et 25 juin; Milan, 6 août; Vienne, 1° novembre : voilà quatre grandes dates de la contre-révolution européenne, quatre bornes qui ont marqué les distances qu'elle a parcourues précipitamment dans sa dernière marche triomphale [1].
À Londres, le 10 avril, ce ne fut pas seulement la puissance révolutionnaire des Chartistes, ce fut aussi la propagande révolutionnaire de février qui fut brisée pour la première fois. Quiconque a une notion exacte de l'Angleterre et de l'ensemble de sa position dans l'histoire moderne ne peut s'étonner que les révolutions du continent défilent devant elle sans laisser de trace.
L'Angleterre, le pays qui, grâce à son industrie et à son commerce, domine toutes les nations en révolution du continent et qui, en vertu de la domination qu'elle exerce sur les marchés asiatiques, américains et australiens, dépend relativement peu de leur clientèle, le pays où les oppositions de la société bourgeoise moderne, les luttes de classes entre la bourgeoisie et le prolétariat sont le plus développées et poussées à l'extrême, l'Angleterre a, plus que tout autre pays, son évolution propre et autonome. L'Angleterre n'a pas besoin des tâtonnements des gouvernements provisoires continentaux pour approcher de la solution des problèmes, de la suppression des oppositions, problèmes et oppositions qu'il lui appartient à elle plus qu'à tout autre pays de résoudre et de supprimer. L'Angleterre n'accepte pas la révolution du continent : Quand son heure sonnera, l'Angleterre dictera la révolution au continent. Voilà quelle était la position de l'Angleterre, voilà quelle était la conséquence nécessaire de cette position et ainsi la victoire de l'« Ordre », le 10 avril était tout à fait explicable. Mais qui ne se rappelle comment cette victoire de l'« Ordre », le premier contrecoup en réponse aux coups de février et de mars, a donné partout à la contre-révolution une consistance nouvelle, a gonflé d'espoirs hardis la poitrine de ceux qu'on appelle les conservateurs. Qui ne se rappelle comment dans toute l'Allemagne l'action des constables spéciaux de Londres fut prise aussitôt comme modèle par toute la milice civique ! Qui ne se souvient de l'impression produite lorsqu'on eut pour la première fois la preuve que le mouvement qui s'était déchaîné n'était pas invincible !
Paris, le 15 mai, offrit aussitôt le pendant à la victoire du parti anglais de l'immobilisme. Le 10 avril avait opposé une digue aux plus hautes vagues du raz de marée révolutionnaire; le 15 mai, la force de celles-ci se brisa à l'endroit même où elles se formaient. Le 10 avril avait démontré que le mouvement de février n'était pas incoercible ! Le 15 mai a démontré qu'on pouvait arrêter le mouvement insurrectionnel de Paris. La révolution, frappée en son centre, ne pouvait manquer de succomber aussi à la périphérie. Et cela eut lieu chaque jour un peu plus en Prusse et dans les États allemands plus petits. Mais le courant révolutionnaire était encore assez fort pour rendre possible à Vienne deux victoires du peuple : la première, le 15 mai également, la seconde, le 26 mai [2] ; et la victoire de l'absolutisme obtenue de haute lutte à Naples, le 15 mai aussi, étant donné ses excès, agit plutôt comme contrepoids à la victoire de l'Ordre à Paris. Il manquait encore quelque chose; non seulement il fallait que le mouvement révolutionnaire fût battu à Paris, il fallait que l'insurrection armée fût dépouillée à Paris même de la magie de l'invincibilité; alors seulement la contre-révolution pourrait être tranquille.
Et cela se produisit à Paris pendant une bataille de quatre jours, du 23 au 26 juin. Quatre jours de canonnades - et les barricades n'étaient plus imprenables, et le peuple armé n'était plus invincible. Par sa victoire Cavaignac avait-il démontré rien d'autre sinon que les lois de l'art militaire sont plus ou moins les mêmes dans la rue et dans un défilé de montagnes, contre les barricades ou contre des abattis d'arbres et des fortifications ? Que 40.000 ouvriers en armes, sans discipline, sans canons et sans obusiers, et sans apport de munitions ne peuvent pas résister plus de quatre jours à une armée organisée de 120.000 soldats chevronnés et 150.000 gardes nationaux soutenus par la meilleure et la plus fournie des artilleries, abondamment pourvue de munitions ? La victoire de Cavaignac c'était l'écrasement à plates coutures du petit nombre par un nombre sept fois supérieur, la victoire la moins glorieuse qui ait jamais été obtenue, et d'autant moins glorieuse qu'elle avait coûté plus de sang malgré une énorme supériorité. Et pourtant le monde l'accueillit avec surprise, comme un miracle – parce que cette victoire de la supériorité numérique avait ravi au peuple de Paris, aux barricades de Paris, l'auréole de l'invincibilité. En l'emportant sur 40.000 ouvriers, les trois cent mille hommes de Cavaignac n'avaient pas seulement vaincu les 40.000 ouvriers, mais aussi, sans le savoir, la révolution européenne. Nous avons tous vu avec quelle force irrésistible, la réaction a déferlé à partir de ce jour-là. Il était impossible de l'arrêter; le pouvoir conservateur avait vaincu le peuple de Paris avec des grenades et de la mitraille, et ce qui était possible à Paris, on pouvait le refaire n'importe où. Après cette défaite décisive, il ne restait à la démocratie rien d'autre à faire qu'à battre en retraite aussi honorablement que possible et à défendre au moins pas à pas dans la presse, dans les assemblées et les parlements le terrain devenu intenable.
Le grand coup qui suivit fut la chute de Milan. La reconquête de Milan par Radetsky représente en fait le premier événement européen depuis la victoire de juin à Paris. L'aigle bicéphale sur le dôme de la cathédrale de Milan, ne signifiait pas seulement la chute de toute l'Italie, elle signifiait aussi la résurrection du centre de gravité de la contre-révolution européenne, la résurrection de l'Autriche. L'Italie battue et l'Autriche ressuscitée - qu'est-ce que la contre-révolution pouvait demander de plus ! Et c'est un fait; depuis la chute de Milan l'énergie révolutionnaire s'est momentanément relâchée en Italie, Mamiani est tombé à Rome, les démocrates ont été vaincus au Piémont; et simultanément en Autriche, le parti réactionnaire a relevé la tête et s'est remis avec un courage nouveau à étendre sur toutes les provinces son réseau d'intrigues dont le Quartier-général de Radetsky formait le centre. C'est seulement à ce moment-là que Jellachich prit l'offensive, que la grande alliance de la contre-révolution avec les Slaves autrichiens a été complètement mise sur pieds.
Je ne parle pas des petits intermèdes au cours desquels la contre-révolution a remporté des victoires locales et conquis des provinces isolées, ni de l'échec de Francfort. Ils ont une importance locale, nationale peut-être, mais aucune pour l'Europe.
Finalement le 1° novembre, l'œuvre commencée le jour de Custozza [3] fut achevée : Windischgrætz et Jellachich investirent Vienne comme Radetsky avait investi Milan. La méthode de Cavaignac a été appliquée au foyer le plus important et le plus actif de la révolution allemande, et avec succès; à Vienne comme à Paris, la révolution a été étouffée dans le sang et les décombres fumants.
Mais on a presque l'impression que la victoire du 1° novembre détermine en même temps le point où le mouvement réactionnaire s'infléchit, et où une crise intervient. La tentative de répéter point par point en Prusse l'exploit de Vienne a échoué; dans le cas le plus favorable, même si le pays devait abandonner l'Assemblée constituante, la Couronne ne peut attendre qu'une demi-victoire qui n'aurait rien de décisif, et, en tout cas, la première impression de découragement produite par la défaite de Vienne est effacée par la tentative maladroite de la copier dans chacun de ses détails.
Et pendant que le nord de l'Europe est rejeté à la servitude de 1847 ou défend péniblement, face à la contre-révolution, les conquêtes des premiers mois, soudain l'Italie recommence à se soulever. Livourne, la seule ville italienne que la chute de Milan ait poussée à une révolution victorieuse, Livourne a enfin communiqué à toute la Toscane son élan démocratique, et imposé un ministère résolument démocratique, plus résolument démocratique que ne le fut aucun ministère dans une monarchie, et aussi résolu que peu de ministères dans une république; un ministère qui répond à la chute de Vienne et à la restauration de l'Autriche en proclamant l'Assemblée nationale italienne. Et le brandon révolutionnaire que ce ministère démocratique a lancé au sein du peuple italien a propagé l'incendie ! À Rome, le peuple, la garde nationale et l'armée se sont dressés comme un seul homme, ont renversé le ministère contre-révolutionnaire qui tergiversait, et obtenu un ministère démocratique, et en tête des revendications que celui-ci a réussi à imposer, il y a celle de gouverner suivant le principe de la nationalité italienne, c'est-à-dire la réunion de la constituante italienne proposée par Guerazzi.
Il n'y a aucun doute que le Piémont et la Sicile suivront. Ils suivront comme ils ont suivi l'an passé.
Et alors ? Cette seconde résurrection de l'Italie sera-t-elle comme la précédente, pendant les trois ans à venir, l'aurore d'un nouvel élan de la démocratie européenne ? On serait presque tenté de le croire. La mesure de la contre-révolution est comble à en déborder : la France, en passe de se jeter dans les bras d'un aventurier pour échapper à tout prix à la domination de Cavaignac et de Marrast, l'Allemagne plus déchirée que jamais, l'Autriche opprimée, la Prusse à la veille de la guerre civile, toutes, toutes les illusions de février et de mars impitoyablement piétinées par la marche tumultueuse de l'histoire. Vraiment le peuple ne pourrait plus rien apprendre avec de nouvelles victoires de la contre-révolution !
Puisse-t-il à la prochaine occasion mettre en pratique à temps et sans avoir peur les enseignements de ces six derniers mois.
Notes
[1] Le 10 avril 1848, à Londres, l'armée et des constables spéciaux dispersèrent une manifestation de Chartistes qui voulaient soumettre au Parlement une troisième pétition demandant l'adoption de la Charte du peuple.
Le 15 mai la garde nationale aida à la répression d'une manifestation pacifique des ouvriers de Paris venus porter à l'Assemblée une pétition en faveur de la Pologne.
Le 25 juin 1848 la révolte du prolétariat de Paris fut étouffée dans le sang.
Le 25 juin 1848, Milan fut occupé par des troupes autrichiennes qui avaient remporté une victoire sur le mouvement de libération nationale de l'Italie du Nord.
Le 1° novembre 1848 les troupes du maréchal Windischgrætz prirent Vienne.
[2] Le 15 mai 1848 des soulèvements d'ouvriers et d'étudiants armés eurent lieu à Vienne pour protester contre la Constitution annoncée le 25 avril par le ministère Pillersdorf. Cette Constitution introduisait le système parlementaire à deux Chambres et un système électoral censitaire qui retirait pratiquement aux ouvriers le droit de vote. Les corvées imposées aux paysans subsistaient. Ces soulèvements étaient dirigés aussi contre le décret du ministère concernant la dissolution du Comité central révolutionnaire composé de délégués des étudiants et de la garde nationale, qui était devenu durant ces journées un centre de la lutte contre la Constitution. Le gouvernement fut contraint de revenir sur la dissolution du Comité central, de déclarer que la Constitution était provisoire et que le Reichstag, la Diète, ne comprendrait qu'une seule Chambre. Le suffrage censitaire fut aboli. Le 26 mai le gouvernement décida de dissoudre la Légion académique, l'organisation militaire des étudiants révolutionnaires. Il y eut de nouveau des soulèvements d'étudiants et d'ouvriers qui obligèrent le gouvernement à renoncer à la dissolution et à faire d'autres concessions.
[3] Le 25 juillet 1848 à Custozza (Italie du Nord), l'armée autrichienne commandée par Radetsky infligea une défaite à l'armée sardo-lombarde.
[Karl Marx, Le mouvement révolutionnaire en Italie, La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 156, 30 novembre 1848]
12:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
05 mai 2018
200 bougies et puis...

Marx a 200 ans aujourd'hui.
Seuls les étourdis peuvent encore l'ignorer tant la presse évoque l'événement, même si c'est trop souvent superficiel et forcément discutable.
D'aucuns parleront peut-être d'épiphénomène, de simple volonté de surfer sur une vague commémorative, de mimétisme médiatique (concurrence oblige), voire d'une vulgaire tentative de détournement politique.
Sans oublier quelque escroquerie intellectuelle, telle cette prise de parole, lors de l'inauguration d'une exposition, par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker !
Et puis, cet anniversaire représente aussi une belle opportunité de récupération commerciale. Ainsi, dans la ville natale de l'auteur du Capital -Trèves-, qui va accueillir des dizaines de milliers de visiteurs, divers gadgets à son effigie sont proposés partout. Comme ce faux billet de zéro €, vendu... 3 € ! Il n'y a décidément pas de petits profits...

Mais ce serait une erreur de limiter la réflexion à ces dérives idéologiques ou mercantiles, à un simple effet de mode ponctuel.
Le fait que la presse bourgeoise évoque un adversaire de la bourgeoisie aussi réputé est un révélateur des paradoxes d'un système, au même titre par exemple que la publication (et la vente) des oeuvres de Marx, ou de multiples ouvrages le concernant, par de grandes maisons d'édition étrangères à toute subversion et obsédées par la rentabilité !
Car cette marchandisation est aussi le résultat de l'existence d'une « demande sociale » authentique, et la principale « valeur d'usage » de celle-ci est d'abord la recherche d'informations concernant une personnalité révolutionnaire majeure ou d'outils d'analyse pour comprendre mieux notre monde dans la perspective de le changer.
Un autre aspect positif est à souligner. Marx est mort en 1883, mais il est toujours politiquement bien vivant, contrairement aux affirmations récurrentes de ses détracteurs. Son oeuvre a gardé toute sa tonicité et son actualité demeure -et demeurera- aussi longtemps que le capitalisme maintiendra sa domination.
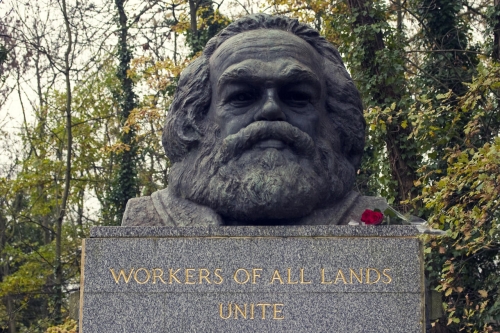
En 2008, lors de la fameuse crise des subprimes, beaucoup -qui avaient enterré Marx de longue date- le redécouvrirent d'ailleurs soudainement, au point que la presse financière elle-même avait réservé ses couvertures au célèbre barbu et lui avait rendu quelques hommages appuyés !
Pour autant, la naïveté n'est pas ici de mise. Que Marx bénéficie ce jour d'une couverture médiatique significative est certes plaisant. Mais ce qui se dit ou s'écrit à son sujet est fréquemment approximatif et l'on échappe difficilement aux caricatures plus ou moins grossières.
La meilleure manière de combattre celles-ci reste la lecture directe de Marx dans le texte, afin de se forger sa propre opinion, avant même de se plonger dans les commentaires de commentateurs professionnels ou dans des études savantes de « spécialistes ».
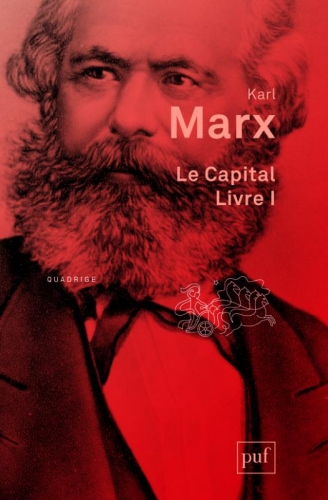
Ce bicentenaire sera donc un succès s'il peut favoriser la (re-)découverte d'une figure incontournable du combat de l'humanité pour son émancipation.
Il appartient à chacun de contribuer à cette réussite...
@
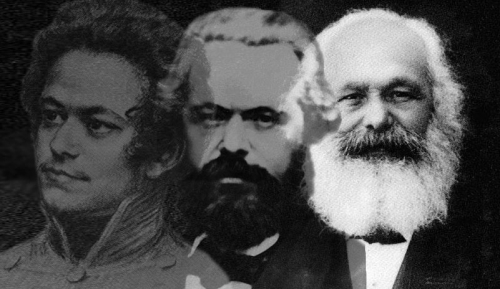
00:36 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
29 avril 2018
Marx sur Arte : un rendez-vous manqué

Ce samedi 28 avril, Arte consacrait la première partie de sa soirée à Karl Marx, en programmant deux documentaires sur l'auteur du Manifeste du Parti Communiste [1].
Une initiative méritoire qui distingue une fois encore la chaîne culturelle franco-allemande de la plupart des autres chaînes de télévision et qui, à ce titre, mérite d'être saluée.
Mais sapristi que d'insuffisances dans ces deux réalisations ! Certes, tout n'est pas à rejeter. De-ci de-là un commentaire fait mouche. Quelques interventions d'historiens sont opportunes et présentent des éclairages pertinents sur l'oeuvre de Marx et sa portée, voire sur les déformations qu'elle a subies de la part de certains de ses «héritiers».
Hélas, à côté de séquences intéressantes, que d'approximations factuelles, que de confusion dans la présentation des principales conceptions de Marx, que d'approches biaisées !
Aucun lieu commun ne nous est épargné :
-
Marx « prophète ». Comme s'il n'était qu'un Nostradamus du mouvement ouvrier naissant ! Et d'ailleurs tous deux ne portaient-ils pas une barbe ? Pourtant, Marx s'est toujours refusé à décrire une quelconque société future modèle et on ne trouve pas dans ses écrits de mentions particulières concernant le XXème siècle à venir ni d'extrapolations audacieuses concernant notre présent. Bref, ni prophète ni auteur de science-fiction [2] !
-
Marx « théoricien ». En chambre et coupé des réalités du monde, comme il se doit ! Alors que Marx ne séparait pas la théorie de la pratique, qu'il fut toute sa vie un militant politique agissant et que son travail «littéraire» était prioritairement destiné à armer idéologiquement et intellectuellement la classe ouvrière dans sa lutte contre la bourgeoisie !
-
Marx « homme aux contradictions multiples ». Qui naturellement interrogent sa cohérence et sa crédibilité. Comme si les conflits (intérieurs) étaient étrangers aux êtres humains, comme s'il était évident de faire totale abstraction de son époque, comme s'il aurait pu échapper complètement aux préjugés du XIXème siècle...
-
Marx « précurseur du totalitarisme communiste », qui a échoué partout où il a été mis en oeuvre. Comme si Marx, décédé en... 1883, était comptable des actes de celles et ceux qui se sont érigés en légataires légitimes de son oeuvre, plusieurs décennies après sa disparition ! De son vivant déjà, Marx avait pris ses distances par rapport à de trop zélés disciples et prévenait : « ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste » !
Et pour étayer ces affirmations polémiques, toujours les mêmes ficelles : un amalgame de citations hors contexte, des libertés prises avec sa biographie et la réalité historique, ou encore des omissions révélatrices.

Ainsi, les exils successifs du jeune Marx, ses contacts avec le prolétariat parisien et les principales figures réformatrices de son temps, son rôle dans les révolutions de 1848 sont effectivement évoqués. Mais après son départ forcé pour Londres, il n'est plus question que de ses difficultés matérielles ou de ses problèmes domestiques d'une part ; et d'autre part de son travail théorique gigantesque pour publier la première partie de son Das Kapital, qui restera au demeurant inachevé. Pas un mot par contre sur la poursuite de ses combats politiques, pas un mot sur la création de l'Association Internationale des Travailleurs en 1864, pas un mot sur l'événement historique qui marqua celle-ci, à savoir la Commune de Paris, pas un mot sur les confrontations idéologiques avec un Lassalle ou un Bakounine ! Non, qu'on se le dise, Marx était définitivement un intellectuel fréquentant régulièrement le British Museum, loin du bruit et la fureur de la lutte des classes concrète, loin des controverses au sein du mouvement social de ces années fondatrices !
Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, que le seul intervenant français retenu soit... Jacques Attali, présenté comme un « biographe » de Marx [3] !
Celui-ci, bien dans le ton de l'émission, explique avec un sourire de circonstance qu'il préfère le « Marx analyste » au « Marx politique ». Car il y aurait un Marx fréquentable, à l'intellect puissant et aux belles intuitions, sur la mondialisation capitaliste notamment. Et puis, il y a le Marx infréquentable, le Marx communiste et révolutionnaire qui s'obstine à vouloir changer le monde. Un objectif abandonné depuis longtemps par l'ancien conseiller de François Mitterrand, qui a par ailleurs largué les amarres avec une social-démocratie pourtant déjà bien peu « socialiste »...
Bon, soyons justes, ce type de production télévisuelle n'est pas vraiment surprenante en cette année commémorative. Le bicentenaire de la naissance de Karl Marx sera par ailleurs évoqué dans les prochains jours par toute la presse mainstream -difficile en effet d'ignorer totalement l'événement- et l'on peut d'ores et déjà en redouter les résultats...

Michel Henry affirmait naguère que « le marxisme est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx » [4]. Je crois qu'en la matière, précisément, nous allons être servis par les célébrations superficielles et les évocations obligées autour du 5 mai. Avec quelques manipulations à la clé et, pour rester dans l'air du temps, un bon paquet de fake news lors des inévitables rétrospectives.
La vigilance critique est plus que jamais de mise...
@
[1] Karl Marx, penseur visionnaire de Chris Twente (https://www.arte.tv/fr/videos/074555-000-A/karl-marx-pens...) et De Marx aux marxistes de Peter Dörfler (https://www.arte.tv/fr/videos/074560-000-A/de-marx-aux-ma...).
[2] Dès 1843, Marx levait toute ambiguïté à ce sujet : « Si construire l'avenir et dresser des plans définitifs pour l'éternité n'est pas notre affaire, ce que nous avons à réaliser dans le présent n'en est que plus évident, je veux dire la critique radicale de tout l'ordre existant ». Marx-Engels, Correspondance Tome I, Novembre 1835-Décembre 1848, Paris, Editions Sociales, 1971, page 298.
[3] Attali a écrit en 2005 un « Marx ou l'esprit du monde », publié chez Fayard. Ce livre, manifestement rédigé rapidement, est parfaitement dispensable !
[4] Henry Michel, Marx, Tome 1, Une philosophie de la réalité, Paris, Gallimard, 1976
13:58 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |


































