26 mars 2020
Orwell, 1903-1950 (VI)

ORWELL
DANS
LE
TEXTE (5)
[George Orwell, Ecrits politiques (1928-1949), Agone, Marseille, 2009]
Dans toute compétition, il y a forcément un gagnant et un perdant. (…) Voilà, en deux mots, la source de tout le mal (p.8)
… dans les quartiers riches la police ne tolère généralement aucune mendicité, même déguisée. D’où il résulte que les mendiants de Londres vivent surtout des pauvres (p.27)
… il est facile de prévoir que, tôt ou tard, les Birmans, comme il arrive dans tous les pays surpeuplés, se verront dépossédés de leurs terres, réduits à l’état de semi-esclaves au service du capitalisme et auront, par surcroît, à souffrir du chômage. Ils découvriront alors ce dont ils se doutent à peine à l’heure actuelle, à savoir que tout ce qui constitue la richesse de leur pays -les puits de pétrole, les mines, la mouture du riz, sa vente et son exportation- est entre les mains britanniques (p.45-46)
Pour commencer, cela devrait ouvrir les yeux du monde extérieur à ce qui est déjà évident pour de nombreux observateurs en Espagne : que le gouvernement actuel a davantage de points de ressemblance que de différences avec le fascisme. (Ce qui ne signifie pas qu’il faille abandonner la lutte contre le fascisme bien plus cru de Franco et d’Hitler. J’ai moi-même commencé à comprendre dès le mois de mai la tendance fasciste du gouvernement, mais je désirais retourner au front, et c’est d’ailleurs ce que j’ai fait.) Deuxièmement, l’élimination du POUM annonce l’attaque imminente contre les anarchistes. Ce sont eux les véritables ennemis que craignent les communistes, bien plus que le POUM numériquement insignifiant (p.61)
La guerre civile n’était pas seulement une guerre mais aussi une révolution. (…) Depuis lors, et surtout depuis décembre de l’année dernière, le véritable combat du gouvernement espagnol a été d’écraser la révolution et de tout remettre dans l’état où il était auparavant. Ils ont plus ou moins réussi à le faire et ont maintenant installé un terrible règne de terreur dirigé contre quiconque est soupçonné de réelles sympathies révolutionnaires (p.64)
J’ai eu la chance de pouvoir sortir d’Espagne mais beaucoup de mes amis et connaissances sont toujours en prison et je crains fort que certains d’entre eux risquent d’être abattus, non pour une infraction quelconque mais pour s’être opposé au parti communiste (…) ce que j’ai vu là-bas m’a tellement secoué que j’écris et que j’en parle à tout le monde. Naturellement, je suis en train d’écrire un livre sur ce sujet (p.65)
Entre-temps, il semble presque impossible de faire imprimer quoi que ce soit à ce sujet (p.68)
Lorsque la révolution a éclaté, les travailleurs, dans beaucoup de régions d’Espagne, ont établi les prémices d’un gouvernement du peuple : ils ont saisi des terres et des usines, ont mis en place des comités locaux, etc. Le gouvernement, qui est en grande partie contrôlé par le parti communiste, a réussi à défaire une grande partie de tout ça, d’abord en demandant aux travailleurs de ne pas compromettre la guerre et, plus tard, quand il s’est senti plus fort, par la force (p.71)
Ce qui en ressort -c’est en tout cas ainsi que je le vois- c’est que le fascisme n’a pas de contraire réel excepté le socialisme. On ne peut pas se battre contre le fascisme au nom de la ‘’démocratie’’ parce que ce nous appelons démocratie, dans un pays capitaliste, ne peut exister que tant que les choses vont bien ; dans les moments de difficulté, elle se transforme immédiatement en fascisme. La seule chose qui peut empêcher cela est pour les travailleurs de garder le pouvoir entre leurs propres mains (p.72)
En conséquence, la seule existence du gouvernement de Front populaire suffisait à soulever le problème le plus compliqué de notre époque : comment effectuer des changements fondamentaux par des méthodes démocratiques (p.78)
Le rôle du journaliste est agréablement stimulant : il doit écrire des articles de propagande. Etrangement, il est possible qu’il se trompe. Nous ne savons pas encore à quoi ressemble un bombardement aérien à grande échelle, et la prochaine guerre risque d’être fort désagréable, même pour les journalistes. Mais ces gens-là, qui sont nés dans l’intelligentsia aisée et sentent dans leurs os qu’ils appartiennent à une classe privilégiée, ne sont pas vraiment capables de prévoir ce genre de choses. La guerre a lieu sur le papier et ils sont donc capables de décider que telle ou telle guerre est ‘’nécessaire’’ sans ressentir plus de danger personnel qu’en déplaçant une pièce d’échecs (p.93)
Car le développement le plus sinistre des vingt dernières années a été la propagation du racisme jusque sur le territoire européen lui-même (p.102)
Le véritable problème se joue entre le socialisme démocratique et une forme de société de caste rationalisée. La première solution a plus de chance de réussir si les pays occidentaux, où les idées démocratiques sont profondément gravées dans l’esprit des gens ordinaires, ne sont pas privés de toute influence (p.104)
Une fois la guerre commencée, la neutralité n’existe plus. Toutes les activités sont des activités de guerre. Qu’on le veuille ou non, on est obligé d’aider soit son propre camp soit celui de l’ennemi (p.105)
… une importante découverte psychologique faite par les nazis -ou en tout cas qu’ils ont appliquée : qu’on peut sans danger prêcher des politiques contradictoires aussi longtemps qu’on dit aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre (p.113)
Nous ne pouvons pas battre Hitler sans passer par la révolution ni consolider notre révolution sans battre Hitler (p.124-125)
Les Etats totalitaires peuvent faire de grandes choses, mais il y a une chose qu’ils ne peuvent pas faire : ils ne peuvent pas donner un fusil à l’ouvrier d’usine et lui dire de le rapporter chez lui pour le mettre dans sa chambre à coucher. Ce fusil accroché au mur de l’appartement de l’ouvrier ou dans la maison du paysan est le symbole de la démocratie. Notre tâche est de vérifier qu’il est toujours là (p.144)
L’expérience montre que les êtres humains peuvent supporter énormément de choses tant qu’ils ont l’impression d’être traités avec justice (p.155)
Pour le dire crûment, le choix est entre le socialisme et la défaite. Nous devons aller de l’avant, ou périr (p.171)
Ce que l’Angleterre n’a jamais eu, c’est un parti socialiste qui soit sérieux et qui tienne compte des réalités contemporaines. (…) En conséquence, le peu de sentiment révolutionnaire qui existait à gauche s’est dispersé dans différentes impasses, dont la plus importante était le parti communiste. Dès le début, le communisme a été une cause perdue en Europe occidentale, et les partis communistes des divers pays ont rapidement dégénéré pour n’être que des agences publicitaires du régime russe (p.172)
Lorsque le véritable mouvement socialiste anglais apparaîtra (…) il traversera toutes les divisions existantes entre les partis. Il sera à la fois révolutionnaire et démocratique (p.173)
Tous les socialistes, et je dirais même quelle que soit leur tendance, sont persuadés que le destin et donc le véritable bonheur de l’homme se trouve dans une société de communisme pur, c’est-à-dire une société où tous les êtres humains sont plus ou moins égaux, où personne n’a le pouvoir d’opprimer quiconque, où les motifs économiques ont cessé d’agir, où les hommes sont mus par l’amour et la curiosité et non par la cupidité et la terreur. Tel est notre destin et il est impossible d’y échapper ; mais comment l’atteindre, et dans combien de temps ? Cela dépend de nous. Le socialisme -la propriété centralisée des moyens de production, plus la démocratie politique- est l’étape nécessaire menant au communisme, exactement comme le capitalisme était l’étape nécessaire après le féodalisme (p.176-177)
Le capitalisme, lui, ne laisse aucune place aux relations humaines ; la seule loi qu’il connaît est l’accumulation incessante des bénéfices (p.177)
On peut définir le nazisme comme un collectivisme oligarchique (p.181)
Les croyances humaines ne sont pas si crûment dépendantes des circonstances matérielles qu’elles puissent changer d’un jour à l’autre, ou même d’une année à l’autre. Un professeur de science naufragé sur une île déserte sera peut-être réduit à la condition d’un sauvage, mais il ne deviendra pas un sauvage. Il ne se mettra pas à croire, par exemple, que le Soleil tourne autour de la Terre. Lorsque notre révolution sera accomplie, notre structure sociale et économique sera totalement différente, mais nous conserverons un bon nombre de façons de penser et de nous comporter que nous avons acquises à une période antérieure. Les nations n’effacent pas si facilement leur passé (p.183-184)
Et au moment où j’écris, j’ignore ce que nous pouvons faire, politiquement, sinon diffuser aussi largement que possible les trois idées suivantes : 1. le progrès de l’humanité peut être bloqué pendant des siècles si nous ne parvenons pas à éliminer Hitler, ce qui signifie que la Grande-Bretagne doit gagner la guerre ; 2. la guerre ne peut pas être gagnée à moins de faire quelques pas en direction du socialisme ; 3. aucune révolution n’a de chance de réussir en Angleterre si elle ne tient pas compte du passé de l’Angleterre (p.185)
Si aucun homme n’est jamais motivé que par des intérêts de classe, pourquoi chaque homme prétend-il toujours qu’il est motivé par autre chose ? Apparemment parce que les êtres humains ne peuvent agir pleinement que lorsqu’ils pensent qu’ils n’agissent pas pour des raisons économiques. Mais ceci devrait suffire en soi-même à suggérer qu’il faudrait prendre au sérieux les motivations ‘’superstructurelles’’ (p.219)
Soit nous vivons tous dans un monde honnête, soit personne n’y vit (p.222)
En pratique, on ne parvient jamais à la société parfaite, et le terrorisme employé dans ce but n’engendre rien d’autre qu’un besoin de terrorisme sans cesse renouvelé (p.248)
Les révolutions doivent se faire, il ne peut pas y avoir de progrès moral sans changements économiques drastiques, et pourtant le révolutionnaire s’active pour rien s’il perd contact avec la décence ordinaire humaine. D’une façon ou d’une autre, il nous faut résoudre le dilemme de la fin et des moyens (p.253)
Un socialiste n’est pas obligé de croire que la société humaine peut réellement devenir parfaite, mais la très grande majorité des socialistes croit vraiment qu’elle pourrait être bien meilleure qu’elle ne l’est à présent, et que la plupart des maux dont les hommes sont responsables proviennent des effets pervers de l’injustice et de l’inégalité. Le fondement du socialisme est l’humanisme. (…) Il ne fait aucun doute que la pensée orthodoxe socialiste, qu’elle soit réformiste ou révolutionnaire, a perdu une partie des qualités messianiques qu’elle possédait il y a trente ans (p.255)
En ce moment, l’utopisme a du mal à se transformer en un mouvement politique bien défini. Partout, les masses cherchent la sécurité plus qu’elles ne veulent l’égalité, et elles n’ont pas compris l’importance, pour elles, de la liberté de parole et de la presse (p.257)
(…) nous pouvons être certains que, d’ici peu, trois pays, peut être davantage, posséderont le moyen de se réduire mutuellement en poussière. Pas plus de quelques centaines de ces bombes, lancées sur les grandes villes et sur les grandes régions industrielles, suffiraient à nous faire revenir à des conditions de sauvagerie primitive (p.278)
Seuls parmi les grands pays du monde, les Etats-Unis n’ont pas souffert trop gravement de la guerre -en fait, ils sont devenus bien plus puissants à cause d’elle (p.287)
Le monde sera divisé en trois camps et, finalement, en deux camps, car la Grande-Bretagne, qui n’est pas assez puissante pour rester seule, finira par s’intégrer au système américain (p.288)
L’époque où le monde pouvait consister en un patchwork de petits Etats réellement indépendants est terminée (p.289)
La majorité des gens ne sait pas ce que le socialisme veut dire, bien que l’opinion publique soit prête à des mesures essentiellement socialistes telles que la nationalisation des mines, des chemins de fer, des services publics et de la terre. Toutefois, il est peu probable qu’il existe un désir très répandu d’une égalité sociale complète. (…) Le parti travailliste, dans l’esprit de l’homme ordinaire, ne signifie pas républicanisme, et encore moins le drapeau rouge, les barricades et le règne de la terreur : il signifie le plein-emploi, la distribution gratuite de lait dans les écoles, trente shillings par semaine pour les retraités et, en général, la justice pour les travailleurs (p.297)
La spécificité remarquable de la presse britannique dans son ensemble est son extrême concentration ; il y a relativement peu de journaux et ils appartiennent pour la plupart à un tout petit cercle de personnes (p.329)
Votre question sur la Ferme des animaux. Bien sûr j’ai conçu ce livre en premier lieu comme une satire sur la révolution russe. Mais, dans mon esprit, il avait une application plus large dans la mesure où je voulais montrer que cette sorte de révolution (une révolution violente menée comme une conspiration par des gens qui n’ont pas conscience d’être affamés de pouvoir) ne peut conduire qu’à un changement de maîtres. La morale, selon moi, est que les révolutions n’engendrent une amélioration radicale que si les masses sont vigilantes et savent comment virer leurs chefs dès que ceux-ci ont fait leur boulot. Le tournant du récit, c’est le moment où les cochons gardent pour eux le lait et les pommes (Kronstadt). Si les autres animaux avaient eu alors la bonne idée d’y mettre le holà, tout se serait bien passé. Si les gens croient que je défends le statu quo, c’est, je pense, parce qu’ils sont devenus pessimistes et qu’ils admettent à l’avance que la seule alternative est entre la dictature et le laisser-faire. Dans le cas des trotskistes s’ajoute une complication particulière : ils se sentent responsables de ce qui s’est passé en URSS jusqu’en 1926 environ, et ils doivent faire l’hypothèse qu’une dégénérescence soudaine a eu lieu à partir de cette date (p.347)
Mon roman récent, 1984, n’a pas été conçu comme une attaque contre le socialisme ou contre le parti travailliste britannique (dont je suis un sympathisant) mais comme une dénonciation des perversions auxquelles une économie centralisée peut être sujette et qui ont déjà été partiellement réalisées dans le communisme et le fascisme. Je ne crois pas que le type de société que je décris arrivera nécessairement, mais je crois (compte tenu, bien entendu, du fait que ce livre est une satire) que quelque chose qui y ressemble pourrait arriver. Je crois également que les idées totalitaires ont partout pris racine dans les esprits des intellectuels, et j’ai essayé de pousser ces idées jusqu’à leurs conséquences logiques. L’action du livre se déroule en Grande Bretagne, pour souligner que les peuples de langue anglaise ne sont pas par nature meilleurs que les autres, et que le totalitarisme, s’il n’est pas combattu, pourrait triompher partout (p.358)
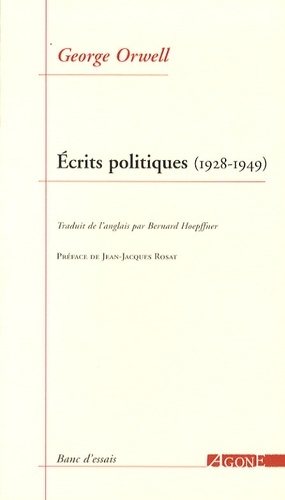
22:20 Publié dans Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
24 février 2020
Orwell, 1903-1950 (V)
 ORWELL
ORWELL
DANS
LE
TEXTE (4)
[George Orwell, A ma guise. Chroniques 1943-1947, Agone, Marseille, 2008]
Les taudis londoniens sont encore bien misérables mais ils ne sont pas comparables à ceux du XIXème siècle. (…) Le progrès existe, si difficile que ce soit de le croire en cette époque de camps de concentration et de belles grosses bombes (p.38)
Presque sans le savoir -et peut-être sans vouloir le savoir- l’ouvrier blanc exploite l’ouvrier de couleur et, en retour, l’ouvrier de couleur peut être utilisé, et est utilisé, contre l’ouvrier blanc. (…) Les choses étant ce qu’elles sont, l’Asie et l’Afrique constituent tout simplement une inépuisable armée de réserve de briseurs de grève. On ne peut pas reprocher au travailleur de couleur de ne pas se sentir solidaire de ses camarades blancs. (…) Le mouvement socialiste n’a jamais vraiment pris pied ni en Asie, ni en Afrique, ni même parmi les Nègres américains : partout, il est dévoyé par le nationalisme et la haine raciale. (…) Il n’y aura pas de solution tant que le niveau de vie du milliard de ‘’non-Blancs’’ ne sera pas relevé de force et rendu égal au nôtre (p.40)
Si l’on veut se croire infaillible, il ne faut pas tenir de journal. En relisant mon journal de 1940 et 1941, je me rends compte que je me suis trompé chaque fois que c’était possible. Mais tout de même moins que les experts militaires (p.45)
Ce que tous ces gens (…) ont en commun, c’est leur refus de croire que la société puisse être fondamentalement améliorée. L’homme n’est pas perfectible, de simples changements politiques ne peuvent avoir aucun effet, et le progrès est une illusion. Le lien entre cette conception et la réaction politique est, bien sûr, manifeste. Le détachement vis-à-vis de ce monde est le meilleur alibi du riche. (…) Il y a un risque à ignorer les néo-pessimistes, car jusqu’à un certain point, ils ont raison. Tant qu’on pense à court terme, il est sage de ne pas trop espérer du futur. Les plans pour l’amélioration de l’humanité tombent régulièrement à l’eau (…) La bonne réponse est de dissocier le socialisme de l’utopisme. (…) La réponse (…) est que le socialisme n’est pas un perfectionnisme, ni même sans doute un hédonisme. Les socialistes ne se prétendent pas capables de rendre le monde parfait ; ils s’affirment capables de le rendre meilleur. Et tout socialiste qui réfléchit tant soit peu concédera au catholique qu’une fois l’injustice économique corrigée le problème fondamental de la place de l’homme dans l’univers continuera de se poser. Mais ce que les socialistes affirment avec force, c’est qu’il est impossible d’affronter ce problème tant que les préoccupations de l’être humain moyen sont, par nécessité, économiques. Tout cela se trouve résumé dans la formule de Marx selon laquelle l’histoire humaine ne pourra commencer qu’après l’avènement du socialisme (p.48-50)
Néanmoins, un monde où l’assassinat d’un seul civil est criminel et où le largage d’un millier de tonnes d’explosifs sur un quartier résidentiel est légitime me fait parfois me demander si notre Terre ne sert pas d’asile psychiatrique à une autre planète (p.54)
… nous sommes tout bonnement une ploutocratie (p.59)
Je crois que les éventuels lecteurs du futur qui se plongeront dans nos journaux et nos magazines considéreront comme une aberration similaire le dédain pour la démocratie et la franche admiration pour le totalitarisme qui se sont emparés de l’intelligentsia britannique vers 1940 (p.65)
Le fait que la démocratie n’est pas inhérente au collectivisme et qu’on ne se débarrasse pas de la domination de classe en abolissant de façon formelle la propriété privée devient chaque jour plus clair. La tendance du monde à se scinder en plusieurs grands blocs formant des superpuissances est également assez claire, et le fait que chacune d’entre elles serait probablement invincible ouvre des perspectives sinistres (p.66)
Burnham (…) était également incapable d’admettre qu’il existe une différence de nature essentielle entre la Russie et l’Allemagne. Mais l’erreur de base de cette pensée est son mépris de l’homme ordinaire (p.67)
Mais là où Burnham et ses savants camarades se trompent, c’est quand ils tentent de propager l’idée que le totalitarisme est inévitable, et que nous ne devrions donc pas nous y opposer (p.68)
Un lecteur me reproche d’être ‘’négatif’’ et ‘’toujours en train de critiquer’’. Le fait est que nous vivons à une époque où les raisons de se réjouir ne sont pas nombreuses (p.71)
L’histoire est écrite par les vainqueurs. En dernière analyse, notre unique titre à la victoire est que, si nous gagnons la guerre, nous proférerons moins de mensonges que nos adversaires. Ce qu’il y a de véritablement effrayant dans le totalitarisme, ce n’est pas qu’il commette des atrocités mais qu’il s’attaque au concept de vérité objective : il prétend contrôler le passé aussi bien que l’avenir (p.81)
La faiblesse de la gauche, c’est qu’elle traite l’antisémitisme d’un point de vue rationaliste. (…) On ne se débarrasse pas d’une croyance en démontrant qu’elle est irrationnelle (p.85-86)
Donc, comme on ne peut pas donner à tout le monde certains produits de luxe (des voitures puissantes, par exemple, des manteaux de fourrures, des yachts, des maisons de campagne et que sais-je encore), il est préférable que personne n’en possède. Le riche perd autant par sa richesse que le pauvre par sa pauvreté (p.95)
On pourrait dire par exemple que ce qu’il y a de plus important dans la théorie de Marx est contenu dans l’adage : ‘’là où est ton trésor, là aussi est ton cœur’’. Mais avant que Marx ne le développe, quel pouvoir avait cet adage ? Qui y a jamais prêté attention ? Qui en avait déduit -ce qu’il implique pourtant indubitablement- que les lois, la religion et les codes moraux constituent une superstructure édifiée sur la base des relations de propriété existantes ? C’est le Christ, selon l’Evangile, qui a prononcé ces paroles, mais c’est Marx qui leur a donné vie. Et depuis qu’il l’a fait, les motivations des hommes politiques, des prêtres, des juges, des moralistes et des millionnaires inspirent la plus profonde suspicion -et c’est bien pourquoi ils le détestent tant (p.100)
… quand on a le ventre creux, le seul problème c’est qu’on a le ventre creux. C’est seulement quand nous serons débarrassés de la corvée et de l’exploitation que nous commencerons vraiment à nous interroger sur la destinée de l’homme et sur le sens de son existence (p.105)
Certes, si la caste militaire allemande n’a pas été détruite, c’est évidemment en raison d’une stratégie délibérée des dirigeants alliés, terrifiés à l’idée d’une révolution en Allemagne (p.124)
La croyance en l’au-delà n’influence pas notre conduite comme elle le ferait obligatoirement si elle était authentique. Avec la perspective de cette existence sans fin par-delà la mort, combien nos vies nous paraîtraient insignifiantes ! La plupart des chrétiens nous affirment qu’ils croient à l’enfer. Mais avez-vous jamais rencontré un chrétien qui paraisse aussi effrayé par l’enfer que par le cancer ? Même les chrétiens les plus dévots plaisanteront sur l’enfer, alors qu’ils ne plaisanteraient pas sur les lépreux ou sur les visages brûlés des pilotes de la Royal Air Force : le sujet est trop douloureux (p.136)
Tout journaliste de la presse quotidienne vous le dira : l’un des secrets les plus importants de son métier, c’est l’astuce qui consiste à faire croire qu’il y a de l’information quand il n’y en a pas (p.139)
Cette illusion consiste à croire que, sous une dictature, on peut être libre intérieurement. Nombre de gens se consolent avec cette idée maintenant que le totalitarisme, sous une forme ou sous une autre, est visiblement en plein essor dans toutes les parties du monde. Dans la rue, les haut-parleurs vocifèrent, les drapeaux flottent sur les toits, les policiers avec leurs mitraillettes patrouillent en tout sens, et le visage du Chef, en un mètre cinquante de large, vous foudroie du regard depuis tous les panneaux d’affichage ; mais là-haut, dans les greniers, les ennemis secrets du régime peuvent consigner leurs pensées en toute liberté ; c’est à peu près l’idée. (…) Mais la pire des erreurs, c’est de s’imaginer que l’être humain est un individu autonome (p.144-145)
Supprimez la liberté d’expression et les capacités créatrices se tarissent (p.145)
La guerre est barbare par nature ; il vaut mieux le reconnaître. Si nous nous regardons comme les sauvages que nous sommes, certains progrès sont possibles ou, du moins envisageables (p.161)
La plupart des êtres humains ont le sentiment qu’une chose devient différente quand on lui attribue un nom différent (p.169)
Le catholique, du moins l’apologiste du catholicisme, se sent tenu d’affirmer la supériorité des pays catholiques et du Moyen-Age sur le monde contemporain, exactement comme un communiste se sent tenu de soutenir l’URSS en toute circonstance (p.185)
Ces nouvelles, et d’autres du même genre, doivent leur qualité à la forte attirance pour la brutalité qui était dans la nature de London. C’est aussi ce qui lui a permis cette compréhension subjective du fascisme qui manque d’ordinaire aux socialistes et qui fait, par certains côtés, du Talon de fer un livre véritablement prophétique (p.192)
L’une des choses les plus extraordinaires avec l’Angleterre, c’est qu’il n’existe pratiquement pas de censure officielle et que, pourtant, rien de ce qui pourrait réellement nuire à la classe dirigeante n’y est jamais publié, du moins dans les journaux à grand tirage. Si ‘’cela ne se fait pas’’ de parler de tel ou tel sujet, eh bien, on n’en parle pas, tout simplement. (…) Pas de pots-de-vin, pas de menaces, pas de sanctions : juste un hochement de tête, un clin d’œil, et le tour est joué. (…) Aujourd’hui, ce type de censure voilée touche aussi les livres. (…) Bien qu’il n’y ait pas d’interdictions expresses ni d’instructions claires sur ce qui doit ou ne doit pas être publié, on ne passe jamais outre la ligne officielle. Les chiens de cirque sautent quand le dresseur fait claquer son fouet, mais le chien vraiment bien dressé est celui qui exécute son saut périlleux sans avoir besoin du fouet (p.195-197)
Mais ces deux dernières années, la publicité commerciale, avec toute sa bêtise et tout son snobisme, a fait un retour en force (p.201)
Après tout, si la nature humaine est immuable, comment se fait-il que non seulement nous ne pratiquons plus le cannibalisme, mais surtout que nous n’en avons même pas envie ? (p.207)
La grande majorité des gens qui vont au cinéma sont pauvres ; il est donc de bonne politique de faire du pauvre un héros. Les grands producteurs de films, les magnats de la presse et leurs semblables amassent une grande partie de leur richesse en faisant valoir que la richesse, c’est le mal. La formule ‘’le gentil pauvre bat le méchant riche’’ n’est qu’une version plus subtile du pays de cocagne. C’est une sublimation de la lutte des classes (p.210)
… il y a extrêmement peu d’esclaves dont on sache quelque chose. Pour ma part, il n’y a que trois esclaves dont je connaisse le nom : Spartacus lui-même ; Esope, le fabuliste, dont on dit qu’il était esclave ; et Epictète, le philosophe, qui était l’un de ces esclaves instruits dont les ploutocrates romains aimaient la compagnie. Tous les autres n’ont même pas de nom. On ne connaît pas -ou tout au moins, je ne connais pas quant à moi- le nom d’un seul de ces millions d’êtres humains qui bâtirent les pyramides. Spartacus est de loin, je pense, l’esclave le plus célèbre qu’il y ait jamais eu. Durant cinq mille ans, ou plus, la civilisation a reposé sur l’esclavage. Pourtant, quand le nom d’un seul esclave traverse les siècles, c’est parce qu’il a désobéi à l’injonction ‘’Ne résiste pas aux méchants’’, et qu’il a organisé une révolte violente. Il y a là, je pense, une morale pour les pacifistes (p.211)
La guerre ne nuit pas à l’édification de la civilisation par la destruction qu’elle engendre (…), ni même par le massacre d’êtres humains, mais par la haine et la malhonnêteté qu’elle suscite. En tirant sur votre ennemi, vous ne lui faites pas de mal au sens le plus profond du terme. Mais en le haïssant, en inventant sur lui des mensonges que vous faites croire à vos enfants, en réclamant à grands cris des conditions de paix injustes qui rendront de nouvelles guerres inévitables, vous frappez non une génération destinée à périr mais l’humanité elle-même (p.214-215)
Quiconque est informé d’un cas avéré de discrimination raciale doit systématiquement le dénoncer (p.220)
Le parti tory était autrefois considéré comme ‘’le parti stupide’’. Mais parmi les promoteurs de ce groupe on trouve quelques bons cerveaux et, lorsque les tories deviennent intelligents, il vaut mieux faire attention à sa montre et compter sa monnaie (p.283)
… les prestidigitateurs ne se convertissent jamais au spiritisme (p.288)
Quoi qu’on dise, les choses évoluent (p.291)
Personne ne cherche la vérité, tout le monde avance des ‘’arguments’’ sans se préoccuper du tout d’impartialité ou d’exactitude, et les faits les plus manifestement évidents peuvent être ignorés par ceux qui ne veulent pas les voir. Les mêmes trucs de propagande se retrouvent presque partout (p.295)
Toutefois, je crois qu’on pourrait démontrer, en se fondant sur l’histoire des vingt dernières années, que les méthodes totalitaires de controverse -falsification de l’histoire, calomnies personnelles, refus d’écouter équitablement les adversaires, et ainsi de suite- sont dans l’ensemble allées à l’encontre des intérêts de la gauche. Le mensonge est un boomerang, et il revient parfois à une vitesse surprenante (p.314)
Je suis tout à fait en faveur de la liberté en Europe, mais je me sens plus heureux quand elle est conjuguée avec la liberté partout ailleurs -en Inde par exemple (p.320)
Pour l’instant, l’avion est tout d’abord un instrument qui sert à lâcher des bombes et la radio est tout d’abord un instrument pour attiser le nationalisme (p.329)
Lorsqu’on examine ce qui s’est passé depuis 1930, il n’est pas facile de croire à la survie de la civilisation. Je ne suggère pas, à partir de ce constat, que la seule solution est de renoncer à la politique quotidienne, de se retirer dans un lieu éloigné et de se concentrer soit sur son salut personnel, soit sur la création de communautés autonomes en prévision du jour où les bombes atomiques auront fait leur travail. Je pense qu’il faut poursuivre la lutte politique, exactement comme un médecin doit tenter de sauver la vie d’un patient, même s’il a de grandes chances de mourir (p.358-359)
La nationalisation est une mesure à long terme qui, dans la plupart des cas, ne produit pas d’amélioration mais prépare simplement le terrain pour une amélioration (p.369)
… Andréï Jdanov (…) en sait à peu près autant sur la littérature que moi sur l’aérodynamisme (p.386)
Le roman de Zamiatine, Nous autres, sur lequel j’ai écrit un article pour Tribune il y a un an ou deux, va être réédité dans ce pays. Il s’agit d’une nouvelle traduction du russe. Repérez bien ce livre (p.400)
Il semble que nationaliser la presse serait du ‘’fascisme’’ alors que la ‘’liberté de la presse’’ consiste à permettre à quelques millionnaires de contraindre plusieurs centaines de journalistes à falsifier leurs opinions (p.445)
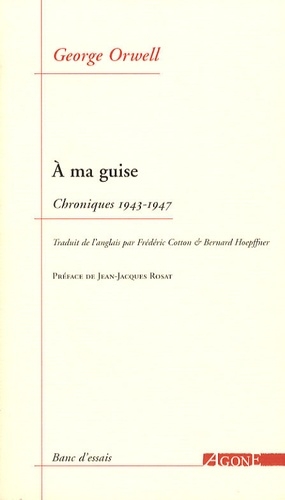
08:56 Publié dans Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
20 février 2020
Orwell, 1903-1950 (IV)

ORWELL
DANS
LE
TEXTE (3)
[George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres, 10/18, Paris, 2010]
J’habitais à l’enseigne de l’hôtel des Trois Moineaux : imaginez une sorte de taupinière sombre et délabrée, abritant, sur cinq étages, quarante chambres délimitées par des cloisons de bois (p.8)
Le sujet de ce livre, c’est la misère, et c’est dans ce quartier lépreux que j’en ai pour la première fois fais l’expérience -d’abord comme une leçon de choses dispensée par des individus menant des vies plus impossibles les unes que les autres, puis comme trame vécue de ma propre existence (p.13)
Je devais à présent subsister avec six francs par jour -entreprise en soi assez ardue pour ne guère laisser le temps de penser à autre chose. C’est à ce moment-là que je commençai à comprendre ce que signifie vraiment la pauvreté. Car six francs par jour, si ce n’est pas à proprement parler la misère, ce n’en est pas loin. Avec six francs par jour, on peut encore subsister à Paris, à condition de savoir s’y prendre. Mais l’affaire n’est pas de tout repos (p.23)
Pourtant, j’étais loin d’être aussi malheureux que je l’aurais cru. Car, lorsque vous vous trouvez dans la misère, vous faites une découverte qui éclipse presque toutes les autres. Vous avez découvert l’ennui, les petites complications mesquines, les affres de la faim, mais vous avez en même temps fait une découverte capitale : savoir que la misère a la vertu de rejeter le futur dans le néant (p.28)
Nous vécûmes plusieurs jours au régime de pain sec, puis je passai deux jour et demi sans manger. Ce n’est pas drôle. Il y a des gens qui font des cures de jeûne de trois semaines et plus, et qui vous assurent qu’à partir du quatrième jour la sensation est positivement délicieuse. Je n’en sais rien, n’étant jamais allé au-delà du troisième jour. Il faut croire que l’on voit la chose différemment quand on se plie de propos délibéré à cette discipline après avoir largement mangé à sa faim avant (p.51)
La faim réduit un être à un état où il n’a plus de cerveau, plus de colonne vertébrale. L’impression de sortir d’une grippe carabinée, de s’être mué en méduse flasque, avec de l’eau tiède qui circule dans les veines au lieu de sang. L’inertie, l’inertie absolue, voilà le principal souvenir que je garde de la faim (p.52)
A cinq heures moins le quart nous reprenions le chemin de l’hôtel. Comme il n’y avait pas de clients à servir avant six heures et demie, nous en profitions pour faire l’argenterie, nettoyer les cafetières et autres ustensiles. Ensuite, c’était le grand branle-bas du dîner. Il me faudrait la plume d’un Zola pour donner une idée de ce qu’était ce moment. En gros, toute l’affaire se résumait comme suit : cent à deux cents personnes réclamaient, chacune en même temps, cinq à six plats différents que devaient leur préparer et servir cinquante à soixante autres personnes. Quiconque a tant soit peut l’expérience de la restauration comprendra ce que cela représente (p.87)
Faire la vaisselle est un travail parfaitement odieux -pas vraiment pénible, certes, mais assommant et stupide au-delà de toute expression. On frémit à l’idée que des êtres humains puissent passer des dizaines d’années de leur vie à ne rien faire d’autre. La femme que je remplaçais avait bien la soixantaine et elle restait rivée à son bac à vaisselle treize heures par jour, six jours par semaine, toute l’année durant. Et en plus, elle servait de souffre-douleur aux garçons (p.93)
Le vol était partout, et malheur à celui qui laissait traîner de l’argent dans la poche de son veston ; il pouvait d’avance en faire son deuil (p.98)
Voilà quelle était la vie d’un plongeur, une vie qui, tout compte fait, ne me paraissait pas alors si mauvaise. Je ne me sentais même pas pauvre, étant donné qu’après avoir payé ma chambre et mis de côté l’argent du tabac, du métro et des repas du dimanche, il me restait quatre francs par jour à dépenser en boisson -et quatre francs, c’était pour moi la fortune (p.123)
… rien ne peut être plus simple que la vie d’un plongeur. Il vit au rythme des heures de travail et des heures de sommeil. Il n’a pas le temps de penser : pour lui, le monde extérieur pourrait aussi bien ne pas exister (p.123)
Le travail de l’hôtel m’enseigna la véritable valeur du sommeil, de même que la faim m’avait enseigné la véritable valeur de la nourriture. Le sommeil avait cessé d’être un simple besoin physique : c’était une volupté, une débauche allant infiniment au-delà du repos nécessaire (p.124)
Il faut, je crois, commencer par souligner que le plongeur est un des esclaves du monde moderne. Loin de moi l’idée de faire verser des larmes sur son sort, car il vit matériellement beaucoup mieux que bien des travailleurs manuels. Mais pour ce qui est de la liberté, il n’en a pas plus qu’un esclave qu’on peut vendre et acheter. Le travail qu’il effectue est servile et sans art. On ne le paie que juste ce qu’il faut pour le maintenir en vie. Ses seuls congés, il les connaît lorsqu’on le flanque à la porte (p.158)
Et on continue à lui imposer ce travail parce que règne confusément chez les riches le sentiment que, s’il avait quelques moments à lui, cet esclave pourrait se révéler dangereux. Et les gens instruits, qui devraient prendre son parti, laissent faire sans broncher parce qu’ils ne connaissent rien de cet homme, et par conséquent en ont peur. Je cite ici le plongeur parce que c’est un cas que j’ai pu examiner de près. Mais on pourrait en dire autant pour une infinité de travailleurs de tous métiers (p.165)
L’Angleterre est un pays fort agréable, à condition de ne pas être pauvre (p.173)
Habillé en clochard, il est très difficile, tout au moins au début, de ne pas éprouver le sentiment d’une déchéance. C’est le même genre de honte, irrationnelle mais très réelle, qui vous prend, je suppose, quand vous passez votre première nuit en prison (p.177)
J’eus, grâce à Bozo, un certain nombre d’aperçus sur la manière dont la mendicité s’organise à Londres. Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Il y a un certain nombre de subdivisions entre catégories, et, socialement parlant, une délimitation franche entre ceux qui se bornent à tendre la main et ceux qui essaient de donner quelque chose en échange de l’argent. Les gains réalisés par ce moyen sont eux aussi très variables (p.231)
Il est regrettable que quelqu’un capable de véritablement traiter le sujet ne s’attache pas à tenir un jour le répertoire de l’argot et des jurons londoniens, en enregistrant précisément les changements qui se produisent. Cela aiderait à comprendre comment et pourquoi un mot naît, vit et meurt (p.244)
L’homme, à qui l’on fait la charité, nourrit, quasi invariablement, une haine féroce à l’égard de son bienfaiteur -c’est une constante de la nature humaine (p.252)
Je tiens toutefois à souligner deux ou trois choses que m’a définitivement enseignées mon expérience de la pauvreté. Jamais plus je ne considérerai tous les chemineaux comme des vauriens et des poivrons, jamais plus je ne m’attendrai à ce qu’un mendiant me témoigne sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce, jamais plus je ne m’étonnerai que les chômeurs manquent d’énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à L’Armée du Salut, ni ne mettrai mes habits en gage, ni ne refuserai un prospectus qu’on me tend, ni ne m’attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant. Ceci pour commencer (p.290)

11:18 Publié dans Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |


































