07 mai 2018
Marx dans le texte (10)

Les ouvriers de Paris ont été écrasés par des forces supérieures; ils n'ont pas succombé. Ils sont battus mais leurs adversaires sont vaincus. Le triomphe momentané de la force brutale est payé par l'anéantissement de toutes les illusions et chimères de la révolution de février, par la désagrégation de tout le parti des vieux républicains, par la scission de la nation française en deux nations, la nation des possédants et la nation des travailleurs. La république tricolore n'arbore plus qu'une seule couleur, la couleur des vaincus, la couleur du sang, elle est devenue la république rouge.
Aux côtés du peuple, aucune voix réputée républicaine, ni du National [1] ni de La Réforme [2] ! Sans autres chefs, sans autres moyens que l'indignation elle-même, il a résisté à la bourgeoisie et à la soldatesque coalisées plus longtemps qu'aucune dynastie française, pourvue de tout l'appareil militaire, ne résista à une fraction de la bourgeoisie coalisée avec le peuple. Pour faire disparaître la dernière illusion du peuple, pour rompre complètement avec le passé, il fallait aussi que les auxiliaires habituels et poétiques de l'émeute française, la jeunesse bourgeoise enthousiaste, les élèves de l'École polytechnique, les tricornes fussent du côté des oppresseurs. Il fallait que les élèves de la Faculté de médecine refusent aux plébéiens blessés le secours de la science. La science n'est pas là pour le plébéien qui a commis l'indicible, l'inexprimable crime de tout risquer pour sa propre existence, et non pour Louis-Philippe ou M. Marrast.
Le dernier vestige officiel de la révolution de février, la Commission exécutive [3], s'est évanouie, comme la brume, devant la gravité des événements. Les feux d'artifice de Lamartine se sont transformés en fusées incendiaires de Cavaignac.
La fraternité, cette fraternité des classes opposées dont l'une exploite l'autre, cette fraternité proclamée en février, écrite en majuscules, sur le front de Paris, sur chaque prison, sur chaque caserne - son expression véritable, authentique, prosaïque, c'est la guerre civile, la guerre civile sous sa forme la plus effroyable, la guerre du travail et du capital. Cette fraternité a flambé devant toutes les fenêtres de Paris le soir du 25 juin, alors que le Paris de la bourgeoisie illuminait, tandis que le Paris du prolétariat brûlait, saignait, gémissait jusqu'à l'épuisement.
La fraternité a duré juste le temps que l'intérêt de la bourgeoisie a été frère de l'intérêt du prolétariat. Des pédants de la vieille tradition révolutionnaire de 1793, des socialistes à l'esprit de système qui mendiaient pour le peuple auprès de la bourgeoisie et qui furent autorisés à tenir de longs sermons et à se compromettre aussi longtemps que le lion prolétarien avait besoin d'être endormi par des berceuses, des républicains qui réclamaient intégralement le vieil ordre bourgeois mais sans tête couronnée, des opposant dynastiques [4] pour qui le hasard avait substitué la chute de la dynastie à un changement de ministre, des légitimistes [5] qui voulaient non pas dépouiller la livrée mais en modifier la coupe, voilà les alliés avec qui le peuple fit février. Ce que d'instinct il haïssait en Louis-Philippe, ce n'était pas Louis-Philippe, c'était la domination couronnée d'une classe, c'était le capital sur le trône. Mais, magnanime comme toujours, il crut avoir anéanti son ennemi après avoir renversé l'ennemi de ses ennemis, l'ennemi commun.
La révolution de février fut la belle révolution, la révolution de la sympathie générale, parce que les contradictions (entre la bourgeoisie et le peuple) qui éclatèrent en elle contre la royauté, n'étaient pas encore développées et demeuraient en sommeil, unies, côte à côte, parce que la lutte sociale qui formait l'arrière-plan de cette révolution, n'avait atteint qu'une existence inconsistante, une existence purement verbale. La révolution de juin est laide; c'est la révolution repoussante, parce que la réalité a pris la place des mots, parce que la République a démasqué la tête même du monstre en lui arrachant la couronne qui la protégeait et la cachait.
L'Ordre ! tel fut le cri de guerre de Guizot. L'Ordre ! cria Sébastiani le guizotin, quand Varsovie devint russe. L'Ordre ! crie Cavaignac, écho brutal de l'Assemblée nationale française et de la bourgeoisie républicaine. L'Ordre ! gronda sa mitraille en déchirant le corps du prolétariat.
Aucune des nombreuses révolutions de la bourgeoisie française depuis 1789 n'était un attentat contre l'Ordre, car toutes laissaient subsister la domination de classe, l'esclavage des ouvriers, l'ordre bourgeois, malgré le changement fréquent de la forme politique de cette domination et de cet esclavage. Juin a touché à cet ordre. Malheur à juin !
Sous le gouvernement provisoire, on fit imprimer sur des milliers d'affiches officielles que les ouvriers au grand cœur « mettaient trois mois de misère à la disposition de la République »; il était donc décent, mieux : nécessaire, c'était à la fois de la politique et de la sentimentalité, de leur prêcher que la révolution de février avait été faite dans leur propre intérêt et que, dans cette révolution, il s'agissait avant tout des intérêts des ouvriers. Depuis que siégeait l'Assemblée nationale - on devenait prosaïque. Il ne s'agissait plus alors que de ramener le travail à ses anciennes conditions, comme le disait le ministre Trélat. Les ouvriers s'étaient donc battus en février pour être jetés dans une crise industrielle.
La besogne de l'Assemblée nationale consiste à faire en sorte que février n'ait pas existé, tout au moins pour les ouvriers qu'il s'agit de replonger dans leur ancienne condition. Et même cela ne s'est pas réalisé, car une assemblée, pas plus qu'un roi, n'a le pouvoir de dire à une crise industrielle de caractère universel : Halte-là ! L'Assemblée nationale, dans son désir zélé et brutal d'en finir avec les irritantes formules de février, ne prit même pas les mesures qui étaient encore possibles dans le cadre de l'ancien état de choses. Les ouvriers parisiens de 17 à 25 ans, elle les enrôle de force dans l'armée ou les jette sur le pavé; les provinciaux, elle les renvoie de Paris en Sologne, sans même leur donner avec le laisser-passer l'argent du voyage; aux Parisiens adultes, elle assure provisoirement de quoi ne pas mourir de faim dans des ateliers organisés militairement, à condition qu'ils ne participent à aucune réunion populaire, c'est-à-dire à condition qu'ils cessent d'être des républicains. La rhétorique sentimentale d'après février ne suffisait pas, la législation brutale d'après le 15 mai [6] non plus. Dans les faits, en pratique, il fallait trancher. Avez-vous fait, canailles, la révolution de février pour vous ou bien pour nous ? La bourgeoisie posa la question de telle façon, qu'il devait y être répondu en juin - avec des balles et par des barricades.
Et pourtant, ainsi que le dit le 25 juin un représentant du peuple, la stupeur frappe l'Assemblée nationale tout entière. Elle est abasourdie quand question et réponse noient dans le sang le pavé de Paris; les uns sont abasourdis parce que leurs illusions s'évanouissent dans la fumée de la poudre, les autres parce qu'ils ne saisissent pas comment le peuple peut oser prendre lui-même en main la défense de ses intérêts les plus personnels. Pour rendre cet événement étrange accessible à leur entendement, ils l'expliquent par l'argent russe, l'argent anglais, l'aigle bonapartiste, le lys et des amulettes de toutes sortes. Mais les deux fractions de l'Assemblée sentent qu'un immense abîme les sépare toutes deux du peuple. Aucune n'ose prendre le parti du peuple.
À peine la stupeur passée, la furie éclate, et c'est à juste titre que la majorité siffle ces misérables utopistes et tartufes qui commettent un anachronisme en ayant toujours à la bouche ce grand mot de Fraternité. Il s'agissait bien en effet de supprimer ce grand mot et les illusions que recèlent ses multiples sens. Lorsque Larochejaquelein, le légitimiste, le rêveur chevaleresque, fulmine contre l'infamie qui consiste à crier « Vae victis ! Malheur aux vaincus ! [7] » la majorité de l'Assemblée est prise de la danse de Saint-Guy comme si la tarentule l'avait mordue. Elle crie : Malheur ! aux ouvriers pour dissimuler que le « vaincu » c'est elle. Ou bien c'est elle qui doit maintenant disparaître, ou c'est la République. C'est pourquoi elle hurle convulsivement : Vive la République !
Le gouffre profond qui s'est ouvert à nos pieds, peut-il égarer les démocrates, peut-il nous faire accroire que les luttes pour la forme de l'État sont vides, illusoires, nulles ?
Seuls des esprits faibles et lâches peuvent soulever pareille question. Les conflits qui naissent des conditions de la société bourgeoise elle-même, il faut les mener jusqu'au bout; on ne peut les éliminer en imagination. La meilleure forme d'État est celle où les contradictions sociales ne sont pas estompées, ne sont pas jugulées par la force, c'est-à-dire artificiellement et donc en apparence seulement. La meilleure forme de gouvernement est celle où ces contradictions entrent en lutte ouverte, et trouvent ainsi leur solution.
On nous demandera si nous n'avons pas une larme, pas un soupir, pas un mot pour les victimes de la fureur du peuple, pour la garde nationale, la garde mobile, la garde républicaine, les troupes de ligne ?
L'État prendra soin de leurs veuves et de leurs orphelins, des décrets les glorifieront, de solennels cortèges funèbres conduiront leurs dépouilles à leur dernière demeure, la presse officielle les déclarera immortels, la réaction européenne leur rendra hommage, de l'Est à l'Ouest.
Quant aux plébéiens, déchirés par la faim, vilipendés par la presse, abandonnés par les médecins, traités par les « gens bien » de voleurs, d'incendiaires, de galériens, leurs femmes et leurs enfants précipités dans une misère encore plus incommensurable, les meilleurs des survivants déportés outre-mer, c'est le privilège, c'est le droit de la presse démocratique de tresser des lauriers sur leur front assombri de menaces.
Notes
[1] Journal fondé le 3 janvier 1830 par Thiers, Mignet, Carrel et Sautelet. Au début son mot d'ordre inspiré par Thiers était d'« enfermer les Bourbons dans la Charte ». Ce journal attaqua vigoureusement le ministère Polignac. Après la révolution de Juillet il soutint le gouvernement de Louis-Philippe, puis lui fit une vive opposition à partir de 1832. À la mort de Carrel, Le National devint républicain avec Marrast qui en fut rédacteur en chef jusqu'en 1848. Le National fut supprimé après le coup d'État de 1851.
[2] Journal de Ledru-Rollin.
[3] La Commission exécutive : gouvernement de la République française créé le 10 mai 1848 par l'Assemblée constituante. Elle remplaça le gouvernement provisoire. Elle exista jusqu'au 24 juin, date où s'instaura la dictature de Cavaignac.
[4] Groupes de députés dirigés par Odilon Barrot qui, sous la monarchie de Juillet, représentaient une tendance modérée de la gauche. Exprimant les concertions des cercles libéraux de la bourgeoisie industrielle et commerçante, ils prirent parti pour une réforme électorale modérée dans laquelle ils voyaient un moyen d'éviter la révolution et de maintenir la dynastie des Orléans. Ils furent les promoteurs de cette Campagne des banquets qui, contrairement à leurs prévisions, aboutit non à une réforme mais à une révolution.
[5] Les légitimistes étaient des partisans de la dynastie « légitime » des Bourbons. Ils représentaient les intérêts de la noblesse terrienne et des grands propriétaires fonciers.
[6] Aucun membre de la Commission exécutive, aucun ministre n'est socialiste; cette exclusion indigne la minorité de gauche qu'exaspèrent le refus de créer un ministère du Travail et l'interdiction de présenter directement des pétitions (12 mai). Ce mécontentement est à l'origine de la journée du 15 mai, pour la plus grande part. En principe, il s'agit d'une manifestation pacifique qui doit porter à l'Assemblée une pétition en faveur de la Pologne. Mais l'obscur travail de certains meneurs (peut-être provocateurs, comme le douteux Huber), les défaillances du service d'ordre et de son chef, le général Courtais, la font très vite dévier. L'Assemblée est envahie, et dans une extrême confusion un nouveau gouvernement provisoire tente de s'organiser. Lamartine et Ledru-Rollin, regroupant les fractions de la Garde nationale, arrivent dans la soirée à rétablir l'ordre, en évitant toute effusion de sang.
Cette journée est « plus qu'une faute politique une faute morale » (George Sand). Elle est sévèrement jugée par une opinion provinciale soucieuse de légalité; elle provoque des arrestations et des poursuites devant la Haute-Cour de Bourges, qui commencent la désorganisation des cadres de gauche (Barbès, Raspail, Blanqui, l'ouvrier Albert sont arrêtés.) Elle motive la suppression de la Commission du Luxembourg (16 mai) et permet la fermeture des clubs les plus avancés. (E. Tersen : Histoire contemporaine (1848-1939).
[7] Cri poussé par Brennus lors de la prise de Rome par les Gaulois.
[Karl Marx , La révolution de juin, La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 29, 29 juin 1848]
Revenons enfin à la Belgique, à notre État constitutionnel « modèle », à l'Eldorado monarchique à base démocratique la plus large, à l'école supérieure des Berlinois diplômés ès arts politiques, à la fierté de la Kölnische Zeitung.
Considérons d'abord la situation économique dont la fameuse Constitution politique ne forme que le cadre doré.
Le Moniteur [1] belge - la Belgique a son Moniteur - donne les nouvelles suivantes du plus grand vassal de Léopold, le paupérisme.
On trouve :
|
dans la province de Luxembourg |
1 habitant secouru sur 69; |
|
dans celle de Namur |
1 habitant secouru sur 17; |
|
dans celle d'Anvers |
1 habitant secouru sur 16; |
|
dans celle de Liège |
1 habitant secouru sur 7; |
|
dans celle de Limbourg |
1 habitant secouru sur 7; |
|
dans celle de Hainaut |
1 habitant secouru sur 6; |
|
dans celles des Flandres orientales |
1 habitant secouru sur 5; |
|
dans celle de Brabant |
1 habitant secouru sur 4; |
|
dans celle des Flandres occidentales |
1 habitant secouru sur 3. |
Cet accroissement du paupérisme va entraîner nécessairement un nouvel accroissement du paupérisme. Avec l'impôt de solidarité que leur imposent leurs concitoyens paupérisés, tous les individus ayant les moyens de mener une existence indépendante perdent leur stabilité bourgeoise et sont également précipités dans le gouffre de la bienfaisance publique. Le paupérisme engendre donc avec une vitesse accrue le paupérisme. Mais à mesure que le paupérisme augmente, la criminalité augmente aussi, et la jeunesse, la source vitale par excellence de la nation, est démoralisée.
Les années 1845, 1846, 1847 nous apportent à cet égard de tristes documents [2].
Nombre des jeunes gens et jeunes filles de moins de 18 ans détenus par décision du tribunal :
|
|
1845 |
1846 |
1847 |
|
Jeunes gens |
2,146 |
4,607 |
7,283 |
|
Jeunes filles |
429 |
1,279 |
2,069 |
|
Total |
2,575 |
5,886 |
9,352 |
|
Total général |
17,813 |
||
Donc, à partir de 1815, le nombre des délinquants juvéniles de moins de 18 ans, a environ doublé chaque année. À ce rythme, en 1850, la Belgique compterait 74.816 délinquants juvéniles, et en 1855 : 2.393.312, c'est-à-dire plus qu'elle n'a de jeunes de moins de 18 ans, et plus de la moitié de sa population. En 1856 toute la Belgique serait en prison, y compris les enfants à naître. La monarchie peut-elle souhaiter une base démocratique plus large ? Au cachot règne l'égalité.
Les routiniers de l'économie nationale ont en vain appliqué les deux pilules de Morrison [3], le libre-échange d'une part, la protection douanière d'autre part. Le paupérisme en Flandres est né sous le système du libre-échange, il a grandi et a forci sous les droits protectionnistes sur le lin et les toiles d'importation.
Pendant que paupérisme et criminalité croissent ainsi dans le prolétariat, les sources de revenu de la bourgeoisie tarissent comme le prouve la publication récente d'un tableau comparatif du commerce extérieur belge pendant le premier semestre des années 1846, 1847, 1848.
Mises à part les fabriques d'armes et de clous exceptionnellement favorisées par la conjoncture, les fabriques de drap qui maintiennent leur ancienne renommée, et la fabrication du zinc qui par comparaison avec l'ensemble de la production est insignifiante, toute l'industrie belge se trouve en état de déclin on de stagnation.
À peu d'exceptions près, on note une diminution considérable de l'exportation des produits des mines belges et de la métallurgie.
Citons quelques exemples :
|
|
1er semestre 1847 |
1er semestre 1848 |
|
Charbon en tonnes |
869.000 |
549.000 |
|
Fonte |
56.000 |
3.5.000 |
|
Articles en fonte |
463 |
172 |
|
Fer, rails de chemins de fer |
3.489 |
13 |
|
Fer forgé manufacturé |
556 |
434 |
|
Serrures |
3.210 |
3.618 |
|
Total général : |
932.718 |
588.237 |
Donc, la diminution totale subie par ces trois articles se monte, pour le premier semestre de 1848, à 344.481 tonnes, soit un peu plus d'un tiers.
Venons-en à l'industrie linière.
|
|
1er semestre 1846 |
1er semestre 1847 |
1er semestre 1848 |
|
Filés de lin |
1.017.000 |
623.000 |
306.000 |
|
Tissus de lin |
1.483.000 |
1.230.000 |
631.000 |
|
Total général |
2.500.000 |
1.853.000 |
987.000 |
Par rapport au semestre de 1846, celui de 1847 accuse une diminution de 657.000 kg et celui de 1848 de 1.613.000 kg ou 64 % [4].
L'exportation de livres, cristaux et verres à vitres a énormément diminué; baisse également sur l'exportation de lin brut et cardé, d'étoupe, d'écorce, de tabac manufacturé.
Le paupérisme qui s'étend, l'emprise inouïe que le crime exerce sur la jeunesse, le déclin systématique de l'industrie belge constituent la base matérielle des réjouissances constitutionnelles : le journal ministériel L'Indépendance compte, - il ne se lasse pas de le proclamer - 4.000 abonnés. Le vieux Mellinet, le seul général qui ait sauvé l'honneur belge, est aux arrêts et comparaîtra dans quelques jours devant les Assises à Anvers. L'avocat gantois Rolin qui a conspiré contre Léopold au profit de la famille d'Orange, et au profit de Léopold de Cobourg contre ses alliés ultérieurs, les libéraux belges, Rolin, deux fois apostat, a obtenu le portefeuille des Travaux publics. L'ex-brocanteur franquillon [5], baron et ministre de la Guerre Cha-a-azal brandit son grand sabre et sauve l'équilibre européen. L'Observateur a enrichi le programme des fêtes de septembre [6] d'une réjouissance nouvelle : une procession - un Ommeganck [7]général - en l'honneur du Doudou de Mons [8] , du Houplala d'Anvers [9] et du Mannequin Pisse [10] de Bruxelles. Voilà le profond sérieux de L'Observateur, le journal du grand Verhaegen. Finalement la Belgique s'est élevée au rang d'école supérieure des Montesquieu de Berlin, d'un Stupp, d'un Grimm, d'un Hansemann, d'un Baumstark et elle jouit de l'admiration de la Kölitische Zeitung. Heureuse Belgique !
Notes
[1] Le Moniteur belge, c'est ainsi que s'appelait d'après le titre de l'organe officiel du gouvernement français, un journal officiel belge, fondé à Bruxelles en 1831.
[2] Les indications suivantes sur la criminalité juvénile en Belgique sont empruntées au mémoire d'Édouard Duepetiaux paru en 1848 à Bruxelles et intitulé : Mémoire sur l'organisation des écoles de réforme.
[4] Les indications concernant l'exportation belge sont empruntées au Moniteur belge, numéro 213 du 31 juillet 1848.
[8] Personnage très populaire dans le Borinage. C'est le méchant dragon terrassé par saint Georges. C'est aussi le nom de la procession annuelle et des réjouissances qui rappellent ce haut-fait. C'est encore un chant wallon qui commence par ces mots : « Nous irons vir l'car d'or ... ! (Nous irons voir le char doré). Cette procession porte en effet officiellement le nom de procession du car d'or. C'est enfin une statuette en bronze enfermée toute l'année jusqu'à la procession annuelle.
[9] Lorsque les Espagnols furent chassés des Flandres, la population anversoise réussit à mettre la main sur le dernier soldat ennemi et le berna en l'envoyant en l'air à de nombreuses reprises dans un drap tendu brutalement à chaque fois. Alors les Anversois criaient : « Op ! Sin-jorken ! » (op ! : en l'air; sinjor : senor prononcé à la flamande; ken : suffixe diminutif marquant le mépris.) L'« Op Sinjorken » est resté un des personnages principaux du folklore anversois. Aujourd'hui encore, la kermesse d'Anvers comporte une brimade symbolique dans laquelle le « Sinjorken » est remplacé par une poupée. Lorsquon lance la poupée, les participants crient : « Houp-la-la ! Houp-la-la ! »
[10] Nous avons respecté l'orthographe de Marx. Cette statue, emblème de Bruxelles, est d'ordinaire désignée sous le nom de Manneken Pis.
[Karl Marx, La Belgique, "État modèle", La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 68, 7 août 1848]
Enfin, après les défaites presqu' ininterrompues de la démocratie depuis six mois, après une série de triomphes les plus inouïs de la contre-révolution, se manifestent enfin pour le parti révolutionnaire les symptômes d'une victoire prochaine. L'Italie, le pays dont le soulèvement a constitué le prélude au soulèvement européen de 1848, dont l'effondrement a été le prélude à la chute de Vienne, l'Italie se soulève pour la seconde fois. La Toscane a imposé son ministère démocratique et Rome vient de conquérir le sien.
Londres, 10 avril; Paris, 15 mai et 25 juin; Milan, 6 août; Vienne, 1° novembre : voilà quatre grandes dates de la contre-révolution européenne, quatre bornes qui ont marqué les distances qu'elle a parcourues précipitamment dans sa dernière marche triomphale [1].
À Londres, le 10 avril, ce ne fut pas seulement la puissance révolutionnaire des Chartistes, ce fut aussi la propagande révolutionnaire de février qui fut brisée pour la première fois. Quiconque a une notion exacte de l'Angleterre et de l'ensemble de sa position dans l'histoire moderne ne peut s'étonner que les révolutions du continent défilent devant elle sans laisser de trace.
L'Angleterre, le pays qui, grâce à son industrie et à son commerce, domine toutes les nations en révolution du continent et qui, en vertu de la domination qu'elle exerce sur les marchés asiatiques, américains et australiens, dépend relativement peu de leur clientèle, le pays où les oppositions de la société bourgeoise moderne, les luttes de classes entre la bourgeoisie et le prolétariat sont le plus développées et poussées à l'extrême, l'Angleterre a, plus que tout autre pays, son évolution propre et autonome. L'Angleterre n'a pas besoin des tâtonnements des gouvernements provisoires continentaux pour approcher de la solution des problèmes, de la suppression des oppositions, problèmes et oppositions qu'il lui appartient à elle plus qu'à tout autre pays de résoudre et de supprimer. L'Angleterre n'accepte pas la révolution du continent : Quand son heure sonnera, l'Angleterre dictera la révolution au continent. Voilà quelle était la position de l'Angleterre, voilà quelle était la conséquence nécessaire de cette position et ainsi la victoire de l'« Ordre », le 10 avril était tout à fait explicable. Mais qui ne se rappelle comment cette victoire de l'« Ordre », le premier contrecoup en réponse aux coups de février et de mars, a donné partout à la contre-révolution une consistance nouvelle, a gonflé d'espoirs hardis la poitrine de ceux qu'on appelle les conservateurs. Qui ne se rappelle comment dans toute l'Allemagne l'action des constables spéciaux de Londres fut prise aussitôt comme modèle par toute la milice civique ! Qui ne se souvient de l'impression produite lorsqu'on eut pour la première fois la preuve que le mouvement qui s'était déchaîné n'était pas invincible !
Paris, le 15 mai, offrit aussitôt le pendant à la victoire du parti anglais de l'immobilisme. Le 10 avril avait opposé une digue aux plus hautes vagues du raz de marée révolutionnaire; le 15 mai, la force de celles-ci se brisa à l'endroit même où elles se formaient. Le 10 avril avait démontré que le mouvement de février n'était pas incoercible ! Le 15 mai a démontré qu'on pouvait arrêter le mouvement insurrectionnel de Paris. La révolution, frappée en son centre, ne pouvait manquer de succomber aussi à la périphérie. Et cela eut lieu chaque jour un peu plus en Prusse et dans les États allemands plus petits. Mais le courant révolutionnaire était encore assez fort pour rendre possible à Vienne deux victoires du peuple : la première, le 15 mai également, la seconde, le 26 mai [2] ; et la victoire de l'absolutisme obtenue de haute lutte à Naples, le 15 mai aussi, étant donné ses excès, agit plutôt comme contrepoids à la victoire de l'Ordre à Paris. Il manquait encore quelque chose; non seulement il fallait que le mouvement révolutionnaire fût battu à Paris, il fallait que l'insurrection armée fût dépouillée à Paris même de la magie de l'invincibilité; alors seulement la contre-révolution pourrait être tranquille.
Et cela se produisit à Paris pendant une bataille de quatre jours, du 23 au 26 juin. Quatre jours de canonnades - et les barricades n'étaient plus imprenables, et le peuple armé n'était plus invincible. Par sa victoire Cavaignac avait-il démontré rien d'autre sinon que les lois de l'art militaire sont plus ou moins les mêmes dans la rue et dans un défilé de montagnes, contre les barricades ou contre des abattis d'arbres et des fortifications ? Que 40.000 ouvriers en armes, sans discipline, sans canons et sans obusiers, et sans apport de munitions ne peuvent pas résister plus de quatre jours à une armée organisée de 120.000 soldats chevronnés et 150.000 gardes nationaux soutenus par la meilleure et la plus fournie des artilleries, abondamment pourvue de munitions ? La victoire de Cavaignac c'était l'écrasement à plates coutures du petit nombre par un nombre sept fois supérieur, la victoire la moins glorieuse qui ait jamais été obtenue, et d'autant moins glorieuse qu'elle avait coûté plus de sang malgré une énorme supériorité. Et pourtant le monde l'accueillit avec surprise, comme un miracle – parce que cette victoire de la supériorité numérique avait ravi au peuple de Paris, aux barricades de Paris, l'auréole de l'invincibilité. En l'emportant sur 40.000 ouvriers, les trois cent mille hommes de Cavaignac n'avaient pas seulement vaincu les 40.000 ouvriers, mais aussi, sans le savoir, la révolution européenne. Nous avons tous vu avec quelle force irrésistible, la réaction a déferlé à partir de ce jour-là. Il était impossible de l'arrêter; le pouvoir conservateur avait vaincu le peuple de Paris avec des grenades et de la mitraille, et ce qui était possible à Paris, on pouvait le refaire n'importe où. Après cette défaite décisive, il ne restait à la démocratie rien d'autre à faire qu'à battre en retraite aussi honorablement que possible et à défendre au moins pas à pas dans la presse, dans les assemblées et les parlements le terrain devenu intenable.
Le grand coup qui suivit fut la chute de Milan. La reconquête de Milan par Radetsky représente en fait le premier événement européen depuis la victoire de juin à Paris. L'aigle bicéphale sur le dôme de la cathédrale de Milan, ne signifiait pas seulement la chute de toute l'Italie, elle signifiait aussi la résurrection du centre de gravité de la contre-révolution européenne, la résurrection de l'Autriche. L'Italie battue et l'Autriche ressuscitée - qu'est-ce que la contre-révolution pouvait demander de plus ! Et c'est un fait; depuis la chute de Milan l'énergie révolutionnaire s'est momentanément relâchée en Italie, Mamiani est tombé à Rome, les démocrates ont été vaincus au Piémont; et simultanément en Autriche, le parti réactionnaire a relevé la tête et s'est remis avec un courage nouveau à étendre sur toutes les provinces son réseau d'intrigues dont le Quartier-général de Radetsky formait le centre. C'est seulement à ce moment-là que Jellachich prit l'offensive, que la grande alliance de la contre-révolution avec les Slaves autrichiens a été complètement mise sur pieds.
Je ne parle pas des petits intermèdes au cours desquels la contre-révolution a remporté des victoires locales et conquis des provinces isolées, ni de l'échec de Francfort. Ils ont une importance locale, nationale peut-être, mais aucune pour l'Europe.
Finalement le 1° novembre, l'œuvre commencée le jour de Custozza [3] fut achevée : Windischgrætz et Jellachich investirent Vienne comme Radetsky avait investi Milan. La méthode de Cavaignac a été appliquée au foyer le plus important et le plus actif de la révolution allemande, et avec succès; à Vienne comme à Paris, la révolution a été étouffée dans le sang et les décombres fumants.
Mais on a presque l'impression que la victoire du 1° novembre détermine en même temps le point où le mouvement réactionnaire s'infléchit, et où une crise intervient. La tentative de répéter point par point en Prusse l'exploit de Vienne a échoué; dans le cas le plus favorable, même si le pays devait abandonner l'Assemblée constituante, la Couronne ne peut attendre qu'une demi-victoire qui n'aurait rien de décisif, et, en tout cas, la première impression de découragement produite par la défaite de Vienne est effacée par la tentative maladroite de la copier dans chacun de ses détails.
Et pendant que le nord de l'Europe est rejeté à la servitude de 1847 ou défend péniblement, face à la contre-révolution, les conquêtes des premiers mois, soudain l'Italie recommence à se soulever. Livourne, la seule ville italienne que la chute de Milan ait poussée à une révolution victorieuse, Livourne a enfin communiqué à toute la Toscane son élan démocratique, et imposé un ministère résolument démocratique, plus résolument démocratique que ne le fut aucun ministère dans une monarchie, et aussi résolu que peu de ministères dans une république; un ministère qui répond à la chute de Vienne et à la restauration de l'Autriche en proclamant l'Assemblée nationale italienne. Et le brandon révolutionnaire que ce ministère démocratique a lancé au sein du peuple italien a propagé l'incendie ! À Rome, le peuple, la garde nationale et l'armée se sont dressés comme un seul homme, ont renversé le ministère contre-révolutionnaire qui tergiversait, et obtenu un ministère démocratique, et en tête des revendications que celui-ci a réussi à imposer, il y a celle de gouverner suivant le principe de la nationalité italienne, c'est-à-dire la réunion de la constituante italienne proposée par Guerazzi.
Il n'y a aucun doute que le Piémont et la Sicile suivront. Ils suivront comme ils ont suivi l'an passé.
Et alors ? Cette seconde résurrection de l'Italie sera-t-elle comme la précédente, pendant les trois ans à venir, l'aurore d'un nouvel élan de la démocratie européenne ? On serait presque tenté de le croire. La mesure de la contre-révolution est comble à en déborder : la France, en passe de se jeter dans les bras d'un aventurier pour échapper à tout prix à la domination de Cavaignac et de Marrast, l'Allemagne plus déchirée que jamais, l'Autriche opprimée, la Prusse à la veille de la guerre civile, toutes, toutes les illusions de février et de mars impitoyablement piétinées par la marche tumultueuse de l'histoire. Vraiment le peuple ne pourrait plus rien apprendre avec de nouvelles victoires de la contre-révolution !
Puisse-t-il à la prochaine occasion mettre en pratique à temps et sans avoir peur les enseignements de ces six derniers mois.
Notes
[1] Le 10 avril 1848, à Londres, l'armée et des constables spéciaux dispersèrent une manifestation de Chartistes qui voulaient soumettre au Parlement une troisième pétition demandant l'adoption de la Charte du peuple.
Le 15 mai la garde nationale aida à la répression d'une manifestation pacifique des ouvriers de Paris venus porter à l'Assemblée une pétition en faveur de la Pologne.
Le 25 juin 1848 la révolte du prolétariat de Paris fut étouffée dans le sang.
Le 25 juin 1848, Milan fut occupé par des troupes autrichiennes qui avaient remporté une victoire sur le mouvement de libération nationale de l'Italie du Nord.
Le 1° novembre 1848 les troupes du maréchal Windischgrætz prirent Vienne.
[2] Le 15 mai 1848 des soulèvements d'ouvriers et d'étudiants armés eurent lieu à Vienne pour protester contre la Constitution annoncée le 25 avril par le ministère Pillersdorf. Cette Constitution introduisait le système parlementaire à deux Chambres et un système électoral censitaire qui retirait pratiquement aux ouvriers le droit de vote. Les corvées imposées aux paysans subsistaient. Ces soulèvements étaient dirigés aussi contre le décret du ministère concernant la dissolution du Comité central révolutionnaire composé de délégués des étudiants et de la garde nationale, qui était devenu durant ces journées un centre de la lutte contre la Constitution. Le gouvernement fut contraint de revenir sur la dissolution du Comité central, de déclarer que la Constitution était provisoire et que le Reichstag, la Diète, ne comprendrait qu'une seule Chambre. Le suffrage censitaire fut aboli. Le 26 mai le gouvernement décida de dissoudre la Légion académique, l'organisation militaire des étudiants révolutionnaires. Il y eut de nouveau des soulèvements d'étudiants et d'ouvriers qui obligèrent le gouvernement à renoncer à la dissolution et à faire d'autres concessions.
[3] Le 25 juillet 1848 à Custozza (Italie du Nord), l'armée autrichienne commandée par Radetsky infligea une défaite à l'armée sardo-lombarde.
[Karl Marx, Le mouvement révolutionnaire en Italie, La Nouvelle Gazette Rhénane, n° 156, 30 novembre 1848]
12:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
24 avril 2018
Le fil rouge de 1968 à 2018
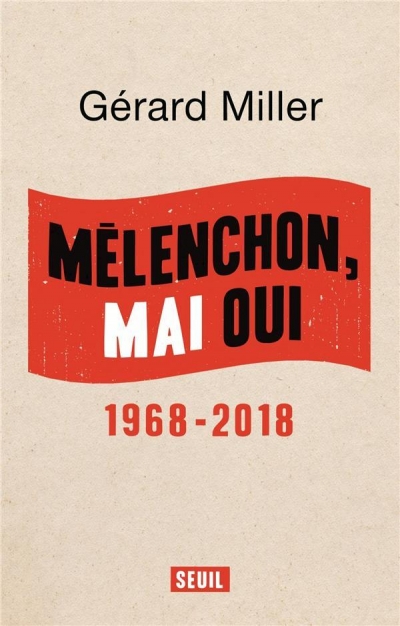
Quel est le point commun entre Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil, Roland Castro et Alain Geismar, Jean-Pierre Le Dantec et Serge July, Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner ?
Tous ont été des «contestataires» en mai 1968, des militants ou compagnons de route du «gauchisme», et souvent même des figures de proue du mouvement de l'époque. Et depuis, tous ont renié leurs engagements pour se rallier au (dés-)ordre du capital.
Il y a 50 ans, ils découvraient la plage sous les pavés ; depuis, ils y ont trouvé le marché, la «mondialisation heureuse» du néo-libéralisme, la «concurrence libre et non faussée» chère à l'Union européenne.
Sans surprise donc, ces «révolutionnaires» défroqués ont soutenu Macron lors de l'élection présidentielle de 2017, en France. Et aujourd'hui, pour la plupart, ils invectivent régulièrement Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Car les «Insoumis» incarnent en 2018 ce qu'ils furent en 1968, et qu'ils ont renié : une opposition au mode de production et de consommation capitaliste, un mouvement qui combat l'oligarchie financière et qui ne veut rien céder aux dominants.
Gérard Miller, ancien militant de l'UJCml [1], retrace d'une écriture alerte les trajectoires et les turpitudes politiques actuelles de certains de ces individus qui ont basculé de la rébellion à la soumission [2].
Il rappelle aussi, à juste titre, que quelques figures médiatiques ne doivent pas occulter l'essentiel : la majorité des acteurs de 68 est restée fidèle, d'une manière ou d'une autre, à ses engagements et aspirations de jeunesse ; dès lors, il serait sot de stigmatiser une prétendue «génération» pour être passée de la lutte pour changer la vie et transformer le monde à la résignation, résumée par la sentence de Thatcher selon laquelle «il n'y a pas d'alternative» !
 Miller a lui aussi vieilli et perdu quelques certitudes, mais il n'a pas oublié ses idéaux ou renoncé à ses convictions. Voilà pourquoi, il soutient Mélenchon. Sans barguigner mais sans un quelconque «culte de la personnalité».
Miller a lui aussi vieilli et perdu quelques certitudes, mais il n'a pas oublié ses idéaux ou renoncé à ses convictions. Voilà pourquoi, il soutient Mélenchon. Sans barguigner mais sans un quelconque «culte de la personnalité».
«Alors, que l'on ne se méprenne pas davantage sur mon mélenchonnisme de 2018. 'il n'est pas de sauveurs suprêmes. Ni Dieu, ni César, ni Tribun' -je n'ai pas oublié les paroles de l'Internationale que je chantais en mai 68. Du coup, même si je connais bien ledit Jean-Luc et que ce sont aussi ses qualités humaines que j'apprécie en lui, ce qui m'importe ce n'est pas le bonhomme, c'est ce dont il est lui aussi le signifiant. Mélenchon, c'est le type qui dit non, celui qui ne se laisse pas faire, celui qui n'écoute pas ces voix obscènes qui susurrent au révolté : 'Mets un peu d'eau dans ton vin et nous le boirons volontiers avec toi'. Je me moque de savoir si le leader de la France Insoumise serait tellement plus présentable s'il se calmait un peu, tellement plus audible s'il était moins intransigeant, tellement plus ceci, tellement plus cela. On ne le changera pas, et d'ailleurs, c'est la société qu'il s'agit de changer, pas lui ! Lui, il est comme il est, et c'est quand même parce qu'il est comme il est qu'il a réussi ce qu'aucun leader contestataire n'avait réussi depuis des lustres (...) : donner autant de couleurs à la gauche et, plus largement, à tous ceux qu'indigne le monde dans lequel nous vivons. Car c'est là ce qui relie également Mélenchon au mouvement de Mai (...)».
Et de boucler avec panache son bouquin : «Alors, c'est l'heure, on compte jusqu'à trois, et à trois on souffle. On souffle sur les cinquante bougies de Mai 68 et, histoire d'être à la hauteur de notre réputation, on souffle un peu plus fort encore sur tous ceux que l'enragé, à l'unisson du poète, essayera toujours de fuir : les grands, les fiers, les prospères, les puissants, mais aussi bien tous les hommes faux, tous les coeurs morts, tous les passants froids, tous ceux qui pour de vains résultats font de vains efforts et qui veulent exister mais pas vivre. Est-ce du Robespierre ? Du Hugo ? Du Mélenchon ? Allez savoir. En tout cas, 'ceux qui vivent sont ceux qui luttent'».
C'est en effet une belle conclusion. Je la signe volontiers.
@
[1] Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, une organisation étudiante maoïste qui éclatera par la suite. Une minorité créera, avec d'autres, la Gauche prolétarienne.
[2] Miller Gérard, Mélenchon, Mai Oui, 1968-2018, Paris, Seuil, 2018 .
20:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
15 mars 2018
Marx dans le texte (9)

(...)
Les économistes ont une singulière manière de procéder. Il n'y a pour eux que deux sortes d'institutions, celles de l'art et celles de la nature. Les institutions de la féodalité sont des institutions artificielles, celles de la bourgeoisie sont des institutions naturelles. Ils ressemblent en ceci aux théologiens, qui, eux aussi, établissent deux sortes de religions. Toute religion qui n'est pas la leur est une invention des hommes, tandis que leur propre religion est une émanation de Dieu. En disant que les rapports actuels - les rapports de la production bourgeoise - sont naturels, les économistes font entendre que ce sont là des rapports dans lesquels se crée la richesse et se développent les forces productives conformément aux lois de la nature. Donc ces rapports sont eux-mêmes des lois naturelles indépendantes de l'influence du temps. Ce sont des lois éternelles qui doivent toujours régir la société. Ainsi il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus. Il y a eu de l'histoire, puisqu'il y a eu des institutions de féodalité, et que dans ces institutions de féodalité on trouve des rapports de production tout à fait différents de ceux de la société bourgeoise, que les économistes veulent faire passer pour naturels et partant éternels.
La féodalité aussi avait son prolétariat - le servage, qui renfermait tous les germes de la bourgeoisie. La production féodale aussi avait deux éléments antagonistes, qu'on désigne également sous le nom de beau côté et de mauvais côté de la féodalité, sans considérer que c’est toujours le mauvais côté qui finit par l'emporter sur le côté beau. C'est le mauvais côté qui produit le mouvement qui fait l'histoire en constituant la lutte. Si, à l'époque du règne de la féodalité, les économistes, enthousiasmés des vertus chevaleresques, de la bonne harmonie entre les droits et les devoirs, de la vie patriarcale des villes, de l'état de prospérité de l'industrie domestique dans les campagnes, du développement de l'industrie organisée par corporations, jurandes, maîtrises, enfin de tout ce qui constitue le beau côté de la féodalité, s'étaient proposé le problème d'éliminer tout ce qui fait ombre à ce tableau - servage, privilèges, anarchie - qu'en serait-il arrivé? On aurait anéanti tous les éléments qui constituaient la lutte, et étouffé dans son germe le développement de la bourgeoisie. On se serait posé l'absurde problème d'éliminer l'histoire.
Lorsque la bourgeoisie l'eut emporté, il ne fut plus question ni du bon, ni du mauvais côté de la féodalité. Les forces productives qui s'étaient développées par elle sous la féodalité, lui furent acquises. Toutes les anciennes formes économiques, les relations civiles qui leur correspondaient, l'état politique qui était l'expression officielle de l'ancienne société civile, étaient brisés.
Ainsi, pour bien juger la production féodale, il faut la considérer comme un mode de production fondé sur l'antagonisme. Il faut montrer comment la richesse se produisait au dedans de cet antagonisme, comment les forces productives se développaient en même temps que l'antagonisme des classes, comment l'une des classes, le mauvais côté, l'inconvénient de la société, allait toujours croissant, jusqu'à ce que les conditions matérielles de son émancipation fussent arrivées au point de maturité. N'est-ce pas dire assez que le mode de production, les rapports dans lesquels les forces productives se développent, ne sont rien moins que des lois éternelles, mais qu'ils correspondent à un développement déterminé des hommes et de leurs forces productives, et qu'un changement survenu dans les forces productives des hommes amène nécessairement un changement dans leurs rapports de production ? Comme il importe avant tout de ne pas être privé des fruits de la civilisation, des forces productives acquises, il faut briser les formes traditionnelles dans lesquelles elles ont été produites. Dès ce moment, la classe révolutionnaire devient conservatrice.
La bourgeoisie commence avec un prolétariat qui lui-même est un reste du prolétariat des temps féodaux. Dans le cours de son développement historique, la bourgeoisie développe nécessairement son caractère antagoniste, qui à son début se trouve être plus ou moins déguisé, qui n'existe qu'à l'état latent. A mesure que la bourgeoisie se développe, il se développe dans son sein un nouveau prolétariat, un prolétariat moderne : il se développe une lutte entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise, lutte qui, avant d'être sentie des deux côtés, aperçue, appréciée, comprise, avouée et hautement proclamée, ne se manifeste préalablement que par des conflits partiels et momentanés, par des faits subversifs. D'un autre côté, si tous les membres de la bourgeoisie moderne ont le même intérêt en tant qu'ils forment une classe vis-à-vis d'une autre classe, ils ont des intérêts opposés, antagonistes, en tant qu'ils se trouvent les uns vis-à-vis des autres. Cette opposition des intérêts découle des conditions économiques de leur vie bourgeoise. De jour en jour, il devient donc plus clair que les rapports de production dans lesquels se meut la bourgeoisie n'ont pas un caractère un, un caractère simple, mais un caractère de duplicité; que dans les mêmes rapports dans lesquels se produit la richesse la misère se produit aussi; que dans les mêmes rapports dans lesquels il y a développement des forces productives, il y a une force productrice de répression; que ces rapports ne produisent la richesse bourgeoise, c'est-à-dire la richesse de la classe bourgeoise, qu'en anéantissant continuellement la richesse des membres intégrants de cette classe et en produisant un prolétariat toujours croissant.
Plus le caractère antagoniste se met au jour, plus les économistes, les représentants scientifiques de la production bourgeoise, se brouillent avec leur propre théorie; et différentes écoles se forment.
Nous avons les économistes fatalistes, qui dans leur théorie sont aussi indifférents à ce qu'ils appellent les inconvénients de la production bourgeoise, que les bourgeois eux-mêmes le sont dans la pratique aux souffrances des prolétaires qui les aident à acquérir des richesses. Dans cette école fataliste, il y a des classiques et des romantiques. Les classiques, comme Adam Smith et Ricardo, représentent une bourgeoisie qui, luttant encore avec les restes de la société féodale, ne travaille qu'à épurer les rapports économiques des tâches féodales, à augmenter les forces productives, et à donner à l'industrie et au commerce un nouvel essor. Le prolétariat Participant à cette lutte, absorbé dans ce travail fébrile, n'a que des souffrances passagères, accidentelles, et lui-même les regarde comme telles. Les économistes comme Adam Smith et Ricardo, qui sont les historiens de cette époque, n'ont d'autre mission que de démontrer comment la richesse s'acquiert dans les rapports de la production bourgeoise, de formuler ces rapports en catégories, en lois, et de démontrer combien ces lois, ces catégories, sont pour la production des richesses supérieures aux lois et aux catégories de la société féodale. La misère n'est à leurs yeux que la douleur qui accompagne tout enfantement, dans la nature aussi bien que dans l'industrie.
Les romantiques appartiennent à notre époque, où la bourgeoisie est en opposition directe avec le prolétariat : où la misère s'engendre en aussi grande abondance que la richesse. Les économistes se posent alors en fatalistes blasés qui, du haut de leur position, jettent un superbe regard de dédain sur les hommes locomotives qui fabriquent les richesses. Ils copient tous les développements donnés par leurs prédécesseurs, et l'indifférence qui chez ceux-là était de la naïveté devient pour eux de la coquetterie.
Vient ensuite l'école humanitaire, qui prend à cœur le mauvais côté des rapports de production actuels. Celle-ci cherche, par acquit de conscience, à pallier tant soit peu les contrastes réels; elle déplore sincèrement la détresse du prolétariat, la concurrence effrénée des bourgeois entre eux-mêmes; elle conseille aux ouvriers d'être sobres, de bien travailler et de faire peu d'enfants; elle recommande aux bourgeois de mettre dans la production une ardeur réfléchie. Toute la théorie de cette école repose sur des distinctions interminables entre la théorie et la pratique, entre les principes et les résultats, entre l'idée et l'application, entre le contenu et la forme, entre l'essence et la réalité, entre le droit et le fait, entre le bon et le mauvais côté.
L'école philanthrope est l'école humanitaire perfectionnée. Elle nie la nécessité de l'antagonisme; elle veut faire de tous les hommes des bourgeois; elle veut réaliser la théorie en tant qu'elle se distingue de la pratique et qu'elle ne renferme pas d'antagonisme. Il va sans dire que, dans la théorie, il est aisé de faire abstraction des contradictions qu'on rencontre à chaque instant dans la réalité. Cette théorie deviendrait alors la réalité idéalisée. Les philanthropes veulent donc conserver les catégories qui expriment les rapports bourgeois, sans avoir l'antagonisme qui les constitue et qui en est inséparable.
(...)
De même que les économistes sont les représentants scientifiques de la classe bourgeoise, de même les socialistes et les communistes sont les théoriciens de la classe prolétaire. Tant que le prolétariat n'est pas encore assez développé pour se constituer en classe, que, par conséquent, la lutte même du prolétariat avec la bourgeoisie n'a pas encore un caractère politique, et que les forces productives ne se sont pas encore assez développées dans le sein de la bourgeoisie elle-même, pour laisser entrevoir les conditions matérielles nécessaires à l'affranchissement du prolétariat et à la formation d'une société nouvelle, ces théoriciens ne sont que des utopistes qui, pour obvier aux besoins des classes opprimées, improvisent des systèmes et courent après une science régénératrice. Mais à mesure que l'histoire marche et qu'avec elle la lutte du prolétariat se dessine plus nettement, ils n'ont plus besoin de chercher de la science dans leur esprit, ils n'ont qu'à se rendre compte de ce qui se passe devant leurs yeux et de s'en faire l'organe. Tant qu'ils cherchent la science et ne font que des systèmes, tant qu'ils sont au début de la lutte, ils ne voient dans la misère que lit misère, sans y voir le côté révolutionnaire, subversif, qui renversera la société ancienne. Dès ce moment, la science produite par le mouvement historique, et s'y associant en pleine connaissance de cause, a cessé d'être doctrinaire, elle est devenue révolutionnaire.
Revenons à M. Proudhon.
Chaque rapport économique a un bon et un mauvais côté c'est le seul point dans lequel M. Proudhon ne se dément pas. Le bon côté, il le voit exposé par les économistes; le mauvais côté, il le voit dénoncé par les socialistes. Il emprunte aux économistes la nécessité des rapports éternels; il emprunte aux socialistes l'illusion de ne voir dans la misère que la misère. Il est d'accord avec les uns et les autres en voulant s'en référer à l'autorité de la science. La science, pour lui, se réduit aux minces proportions d'une formule scientifique ; il est l'homme à la recherche des formules. C'est ainsi que M. Proudhon se flatte d'avoir donné la critique et de l'économie politique et du communisme : il est au-dessous de l'une et de l'autre. Au-dessous des économistes, puisque comme philosophe, qui a sous la main une formule magique, il a cru pouvoir se dispenser d'entrer dans des détails purement économiques; au-dessous des socialistes, puisqu'il n'a ni assez de courage, ni assez de lumières pour s'élever, ne serait-ce que spéculativement, au-dessus de l'horizon bourgeois.
Il veut être la synthèse, il est une erreur composée.
Il veut planer en homme de science au-dessus des bourgeois et des prolétaires; il n'est que le petit bourgeois, ballotté constamment entre le Capital et le Travail, entre l'économie politique et le communisme.
(...)
Malgré les uns et les autres, malgré les manuels et les utopies, les coalitions n'ont pas cessé un instant de marcher et de grandir avec le développement et l'agrandissement de l'industrie moderne. C'est à tel point maintenant, que le degré où est arrivé la coalition dans un pays, marque nettement le degré qu'il occupe dans la hiérarchie du marché de l'univers. L'Angleterre, où l'industrie a atteint le plus haut degré de développement, a les coalitions les plus vastes et les mieux organisées.
En Angleterre, on ne s'en est pas tenu à. des coalitions partielles, qui n'avaient pas d'autre but qu'une grève passagère, et qui disparaissaient avec elle. On a formé des coalitions permanentes, des trades-unions qui servent de rempart aux ouvriers dans leurs luttes avec les entrepreneurs. Et à l'heure qu'il est, toutes ces trades-unions locales trouvent un point d'union dans la National Association of United Trades, dont le comité central est à Londres, et qui compte déjà 80 000 membres. La formation de ces grèves, coalitions, trades-unions marcha simultanément avec les luttes politiques des ouvriers qui constituent maintenant un grand parti politique sous le nom de Chartistes.
C'est sous la forme des coalitions qu'ont toujours lieu les premiers essais des travailleurs pour s'associer entre eux.
La grande industrie agglomère dans un endroit une foule de gens inconnus les uns aux autres. La concurrence les divise d'intérêts. Mais le maintien du salaire, cet intérêt commun qu'ils ont contre leur maître, les réunit dans une même pensée de résistance - coalition. Ainsi la coalition a toujours un double but, celui. de faire cesser entre eux la concurrence, pour pouvoir faire une concurrence générale au capitaliste. Si le premier but de résistance n'a été que le maintien des salaires, à mesure que les capitalistes à leur tour se réunissent dans une pensée de répression, les coalitions, d'abord isolées, se forment en groupes, et en face du capital toujours réuni, le maintien de l'association devient plus nécessaire pour eux que celui du salaire. Cela est tellement vrai, que les économistes anglais sont tout étonnés de voir les ouvriers sacrifier une bonne partie du salaire en faveur des associations qui, aux yeux de ces économistes, ne sont établies qu'en faveur du salaire. Dans cette lutte - véritable guerre civile - se réunissent et se développent tous les éléments nécessaires à une bataille à venir. Une fois arrivée à ce point-là, l'association prend un caractère politique.
Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts communs. Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte, dont nous n'avons signalé que quelques phases, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte politique.
Dans la bourgeoisie, nous avons deux phases à distinguer celle pendant laquelle elle se constitua en classe sous le régime de la féodalité et de la monarchie absolue, et celle où, déjà constituée en classe, elle renversa la féodalité et la monarchie, pour faire de la société une société bourgeoise. La première de ces phases fut la plus longue et nécessita les plus grands efforts. Elle aussi avait commencé par des coalitions partielles contre les seigneurs féodaux.
On a fait bien des recherches pour retracer les différentes phases historiques que la bourgeoisie a parcourues, depuis la commune jusqu'à sa constitution comme classe.
Mais quand il s'agit de se rendre un compte exact des grèves, des coalitions et des autres formes dans lesquelles les prolétaires effectuent devant nos yeux leur organisation comme classe, les uns sont saisis d'une crainte réelle, les autres affichent un dédain transcendantal.
Une classe opprimée est la condition vitale de toute société fondée sur l'antagonisme des classes. L'affranchissement de la classe opprimée implique donc nécessairement la création d'une société nouvelle. Pour que la classe opprimée puisse s'affranchir, il faut que les pouvoirs productifs déjà acquis et les rapports sociaux existants ne puissent plus exister les uns à côté des autres. De tous les instruments de production, le plus grand pouvoir productif, c'est la classe révolutionnaire elle-même. L'organisation des éléments révolutionnaires comme classe suppose l'existence de toutes les forces productives qui pouvaient s'engendrer dans le sein de la société ancienne.
Est-ce à dire qu'après la chute de l'ancienne société il y aura une nouvelle domination de classe, se résumant dans un nouveau pouvoir politique ? Non.
La condition d'affranchissement de la classe laborieuse c'est l'abolition de toute classe, de même que la condition d'affranchissement du tiers état, de l'ordre bourgeois, fut l'abolition de tous les états et de tous les ordres.
La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développement, à l'ancienne société civile une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et il n'y aura plus de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l'antagonisme dans la société civile.
En attendant, l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie est une lutte de classe à classe, lutte qui, portée à sa plus haute expression, est une révolution totale. D'ailleurs, faut-il s'étonner qu'une société, fondée sur l'opposition des classes, aboutisse à la contradiction brutale, à un choc de corps à corps comme dernier dénouement ?
Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique. Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps.
(...)
[Misère de la philosophie, 1847]
18:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |


































