06 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [106]
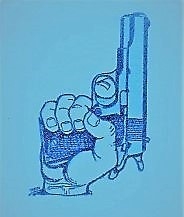 "Pourquoi ? Ça empêchent pas les soldats de dormir. Ils assassinent et ils reçoivent des médailles pour le faire. Les bonnes gens du Kansas veulent m'assassiner, et il y a certainement un bourreau qui sera content d'obtenir le boulot. C'est facile de tuer, beaucoup plus facile que de passer un mauvais chèque. Souviens-toi : je n'ai connu les Clutter que durant une heure peut-être. Si je les avais réellement connus, j'imagine que je ressentirais autre chose. J'pense pas que je pourrais vivre avec moi-même. Mais la façon dont ça s'est passé, c'était comme casser des pipes dans un stand de tir."
"Pourquoi ? Ça empêchent pas les soldats de dormir. Ils assassinent et ils reçoivent des médailles pour le faire. Les bonnes gens du Kansas veulent m'assassiner, et il y a certainement un bourreau qui sera content d'obtenir le boulot. C'est facile de tuer, beaucoup plus facile que de passer un mauvais chèque. Souviens-toi : je n'ai connu les Clutter que durant une heure peut-être. Si je les avais réellement connus, j'imagine que je ressentirais autre chose. J'pense pas que je pourrais vivre avec moi-même. Mais la façon dont ça s'est passé, c'était comme casser des pipes dans un stand de tir."
[Truman Capote, De sang froid, 1966]
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
05 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [105]
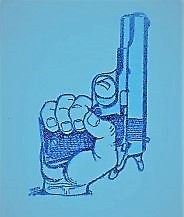 "Ses vêtements étaient mouillés, chauds, et ils sentaient mauvais. Du sang. Elle allait mourir.
"Ses vêtements étaient mouillés, chauds, et ils sentaient mauvais. Du sang. Elle allait mourir.
La mort. Elle allait mourir. Elle le savait. A travers la petite lumière vacillante dans son esprit, elle le sentait.
Quelqu'un l'avait tuée... l'homme qui lui avait pris sa pièce lui avait pris la vie."
[Mary Higgins Clark, La nuit du renard, 1977]
00:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
04 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [104]
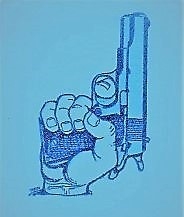 "La mort, c'est mon truc. C'est grâce à elle que je gagne ma vie. Que je bâtis ma réputation professionnelle. Je la traite avec la passion et la précision d'un entrepreneur de pompes funèbres, grave et compatissant quand je suis en présence des personnes en deuil, artisan habile quand je suis seul avec elle. J'ai toujours pensé que, pour s'occuper de la mort, le secret était de la tenir à distance. C'est la règle. Ne jamais la laisser vous souffler dans la figure.
"La mort, c'est mon truc. C'est grâce à elle que je gagne ma vie. Que je bâtis ma réputation professionnelle. Je la traite avec la passion et la précision d'un entrepreneur de pompes funèbres, grave et compatissant quand je suis en présence des personnes en deuil, artisan habile quand je suis seul avec elle. J'ai toujours pensé que, pour s'occuper de la mort, le secret était de la tenir à distance. C'est la règle. Ne jamais la laisser vous souffler dans la figure.
Hélas, cette règle, la même, ne m'a pas protégé. Quand les deux inspecteurs sont venus me chercher et m'ont parlé de Sean, une sorte de paralysie glacée m'a aussitôt envahi."
[Michael Connelly, Le poète, 1996]
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
03 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [103]
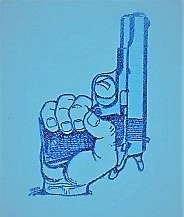 "Dans la rue, il commençait à crachiner. Deux cavaliers pressèrent le trot de leurs chevaux et dépassèrent une Ford bringuebalante. Executor ouvrit la porte de la Packard blindée et aida le journaliste à s’asseoir.
"Dans la rue, il commençait à crachiner. Deux cavaliers pressèrent le trot de leurs chevaux et dépassèrent une Ford bringuebalante. Executor ouvrit la porte de la Packard blindée et aida le journaliste à s’asseoir.
− Ça commence à bien faire. Il nous faut de l’action.
− La veuve m’a juré qu’elle et ses amis n’y étaient pour rien.
− Qui alors ?
− Pas la moindre idée. Mais tu as raison. Ça suffit comme ça.
− Personne ne proteste de son innocence tant qu’une accusation n’a pas été lancée. Personne ne donne de réponses si on ne lui pose pas de questions.
− Tu as raison. Il faudrait commencer par là.
− Hier, on a tiré sur le poète et on a failli le tuer. Mettons la pression et voyons si l’Ombre sort de l’obscurité et se montre, dit l’Executor en démarrant.
− L’Ombre ? Quelle Ombre ?
− L’ennemi. C’est comme ça que le poète l’appelle. Quant à notre club de joueurs de dominos, il lui a trouvé un nom encore plus lyrique : l’Ombre de l’ombre.
− Pas mal du tout. On pourrait l’embaucher au journal."
[Paco Ignacio Taibo II, Ombre de l’ombre, 1986]
00:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
02 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [102]
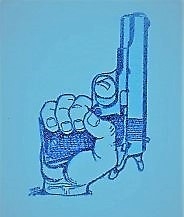 "Je raccroche, et je regagne la Voyager sur un nuage. Je ne pourrais pas être plus heureux si j’avais moi-même un boulot. C’est vrai ; enfin, presque vrai. Mais il travaille, il a un poste, il est là où il veut être !
"Je raccroche, et je regagne la Voyager sur un nuage. Je ne pourrais pas être plus heureux si j’avais moi-même un boulot. C’est vrai ; enfin, presque vrai. Mais il travaille, il a un poste, il est là où il veut être !
Mon Dieu, je n’ai pas besoin de le tuer.
Oh, c’est super, c’est super. En démarrant la Voyager, en faisant le demi-tour, je souris jusqu’aux oreilles.
Tandis que les kilomètres défilent, que je me rapproche de plus en plus de la maison, le poids me retombe lentement dessus. Encore deux."
[Donald Westlake, Le couperet, 1997]
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
01 décembre 2020
IMAGINAIRE(S) [101]
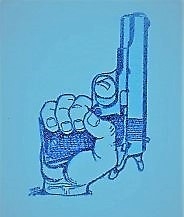 "Il resta étendu là jusqu’à ce qu’il fût certain que la cour fût vide. Il pensa à l’amour de sa vie et imagina qu’elle était avec lui, la tête reposant sur sa poitrine, lui disant combien elle aimait les sonnets qu’il composait pour elle.
"Il resta étendu là jusqu’à ce qu’il fût certain que la cour fût vide. Il pensa à l’amour de sa vie et imagina qu’elle était avec lui, la tête reposant sur sa poitrine, lui disant combien elle aimait les sonnets qu’il composait pour elle.
Il se remit enfin debout. C’était dur de marcher ; chaque pas lui déchirait de douleur les entrailles jusqu’à la poitrine. Il se tâta le visage ; ce dernier était couvert de quelque chose de sec qui ne pouvait être que du sang. De la manche, il se frotta le visage avec furie jusqu’à ce que le sang frais coulât des écorchures sur une peau douce. Il se sentit mieux du coup, et le fait qu’il n’ait pas pleuré le fit se sentir encore mieux."
[James Ellroy, Lune sanglante, 1984]
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
30 novembre 2020
IMAGINAIRE(S) [100]
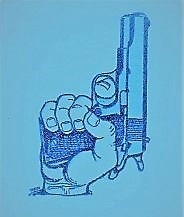 "− Siggie Reuhr est probablement capable de bien des choses, mais d’un meurtre, ça, non. Comment a-t-il été descendu, le type ?
"− Siggie Reuhr est probablement capable de bien des choses, mais d’un meurtre, ça, non. Comment a-t-il été descendu, le type ?
− A coup de hache.
− Alors, il y a eu du sang ?
− Je pense bien !
− Alors vous pouvez rayer Siggie de votre liste. Le poison, je ne dis pas. Mais une hache ! Du sang ! C’est tout juste si Siggie ne tournait pas de l’œil s’il lui arrivait de se couper le doigt sur la tranche d’un grand livre. La vue du sang le rendait malade. Non, inspecteur, si votre type s’est fait descendre à coup de hache, croyez-moi, ce n’est pas du côté de Siggie qu’il faut chercher."
[Ed McBain, La hache, 1964]
00:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
29 novembre 2020
IMAGINAIRE(S) [99]
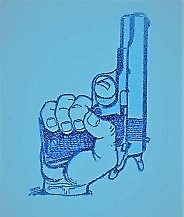 "Fossoyeur et Ed Cercueil étaient installés en bras de chemise à la table la plus éloignée du fourneau, leur veston accroché au dossier de leur chaise. Les pardessus, surmontés de leurs vieux feutres noirs déformés, étaient accrochés à un clou, près de la porte. La sueur perlait sur leur crâne laineux aux cheveux coupés court et ruisselait sur leur visage noir. Les cheveux d’Ed Cercueil étaient poivrés et gris. Partant de l’oreille droite, une cicatrice en forme de croissant barrait le crâne de Fossoyeur, souvenir du coup de crosse qu’Ed Cercueil, aveuglé par du vitriol, lui avait assené. Plus de trois ans s’étaient écoulés depuis cette sombre histoire. Les médecins avaient pratiqué sur le visage brûlé à l’acide d’Ed Cercueil de nombreuses greffes de peau prélevées sur ses cuisses. Mais cette peau, d’un ton plus clair que celle de son visage ayant été greffée par pièces et morceaux, Ed Cercueil semblait avoir passé entre les mains d’un maquilleur d’Hollywood qui lui aurait fait la tête de Frankenstein. Quant à la face bossuée de Fossoyeur, rien ne la distinguait de celles des innombrables bagarreurs de Harlem."
"Fossoyeur et Ed Cercueil étaient installés en bras de chemise à la table la plus éloignée du fourneau, leur veston accroché au dossier de leur chaise. Les pardessus, surmontés de leurs vieux feutres noirs déformés, étaient accrochés à un clou, près de la porte. La sueur perlait sur leur crâne laineux aux cheveux coupés court et ruisselait sur leur visage noir. Les cheveux d’Ed Cercueil étaient poivrés et gris. Partant de l’oreille droite, une cicatrice en forme de croissant barrait le crâne de Fossoyeur, souvenir du coup de crosse qu’Ed Cercueil, aveuglé par du vitriol, lui avait assené. Plus de trois ans s’étaient écoulés depuis cette sombre histoire. Les médecins avaient pratiqué sur le visage brûlé à l’acide d’Ed Cercueil de nombreuses greffes de peau prélevées sur ses cuisses. Mais cette peau, d’un ton plus clair que celle de son visage ayant été greffée par pièces et morceaux, Ed Cercueil semblait avoir passé entre les mains d’un maquilleur d’Hollywood qui lui aurait fait la tête de Frankenstein. Quant à la face bossuée de Fossoyeur, rien ne la distinguait de celles des innombrables bagarreurs de Harlem."
[Chester Himes, Imbroglio negro, 1959]
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |

































