02 février 2023
"BOUQUINAGE" - 137
"Dans la voiture électrique, Pépère, son petit cartable sur les genoux et les yeux droits devant, songe au mensonge... Pas seulement à ceux de ses gosses. Le mensonge en général. Le mensonge intime et sociétal. Le mensonge comme moyen de communication, comme modèle de gouvernement, comme stratégie et comme force de gestion. Ce qu'on peut faire avaler à l'électeur, quand même, au citoyen, au client, à l'employé, au riverain... La mairesse, avec ses plages. On aura beau dire, ils sont forts. On peut toujours s'aligner, nous autres, avec nos petits moyens... Le mensonge, lui, Pépère, jamais. Ses gars, il ne leur a jamais fait prendre des vessies pour des lanternes. Il les a éduqués à la vérité cash. Le monde tel qu'ils est. Sans sauce. On ne ment pas. Ou si on ment c'est à la police et c'est servir la vérité. Sinon, on meurt."
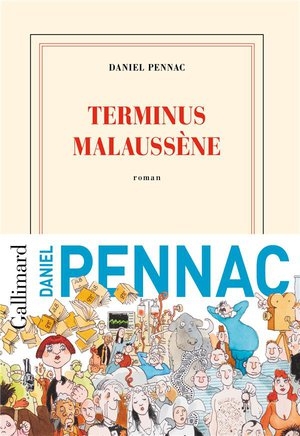
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
01 février 2023
"BOUQUINAGE" - 136


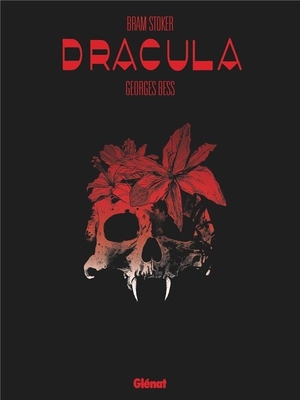
00:00 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
31 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 135
"La SF ne vise pas à nous couper de notre réalité pour nous plonger, désarmés, dans le grand et terrifiant inconnu. Tout à l'inverse, elle nous parle de nous et encore de nous, ne serait-ce que parce que les humaines capacités des auteurs les contraignent à se débattre dans les limites étroites de leur propre nature. La science-fiction, en somme, n'est jamais qu'un détour. Son pari est qu'il est possible d'en apprendre davantage sur nous-mêmes en élargissant le champ de l'espace, intérieur ou extérieur, et celui du temps, vers le passé ou le futur. Tenter de décrire une race extraterrestre revient forcément à nous interroger sur ce que nous sommes on ne sommes pas. Imaginer le futur ou un passé alternatif (uchronie) conduit à juger le présent. Dans la SF comme dans toute autre littérature, qu'on le veuille ou non, l'homme, et même l'homme contemporain, demeure la seule véritable référence, l'étalon de toute construction imaginaire. Le lointain, l'ailleurs, l'autre se définissent à ce qu'ils sont ou pas semblables à nous par des différences et des ressemblances. Il n'en est pas moins exact que nous interroger sur ce que nous sommes est rarement réjouissant, et que nous demander où cela nous conduit ne l'est pas davantage."
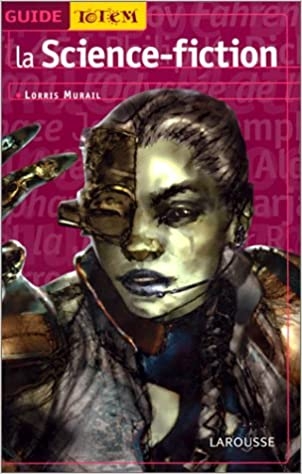
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
30 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 134
"Pauvre Luke, il a bonne mine ! se dit Barron qui se marrait à l'idée que ces quatre types réunis dans une salle enfumée n'avaient qu'un mot à dire pour faire de lui un candidat présidentiel. S'ils savaient que Howards peut les acheter quand il veut un par un et à peu de frais ! Et Bennie n'est qu'un pauvre conard que je me charge de faire tourner en bourrique malgré ses cinquante milliards. Tout ça c'est du show-business, la politique c'est du show-business mais sans la classe, et toutes ces grosses têtes d'enflés sont des types comme vous et moi madame. Au jeu du Bug Jack Barron, même sans ma sellette magique, ils n'ont aucune chance contre moi parce qu'ils sont sérieux et que moi je ne joue que pour la galerie.
Ce fut Kaplan qui récupéra le premier.
— Toujours le même, hein, Jack ! fit le maire de Strip City avec comme un soupçon d'envie dans la voix. Mais ne te leurre pas, cette fois-ci ce n'est plus comme avant, toutes les billes sont en jeu.
— Toutes les billes à toi, peut-être, mais pas les miennes. Et vous feriez mieux de me croire, vous tous, parce que vous perdez votre temps si vous vous figurez que je vais dire amen à n'importe laquelle de vos élucubrations rien que pour avoir l'honneur de vous servir d'homme de paille. Vous avez votre tambouille à faire et moi la mienne. Si nous pouvons nous servir du même feu c'est très bien. Sinon au revoir.
— O.K., nous jouerons selon vos règles, fit Masterson. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi c'est la tête de Russ Deacon qui m'intéresse. Et Woody veut la même chose. Livrez le morceau, et nous avons assez de voix aux Assises nationales pour vous faire passer.
Voilà donc l'explication, se dit Barron. Oui, ça se comprend. Pauvre Russ, c'est lui qui serait ici à jouer ce jeu dégueulasse si Luke pensait qu'il détenait les bonnes cartes. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, ce sont les concessions qu'on fait pour l'avoir."
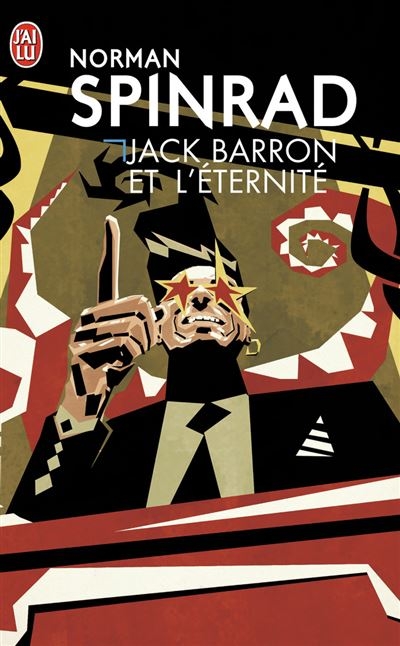
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
29 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 133
"Succès d'édition immédiats, la trilogie de J.R.R. Tolkien mais aussi les romans de C.S. Lewis exercent une influence considérable dès leur sortie, notamment sur la génération contestataire des années 1960. La publication du Seigneur des anneaux correspond au moment où la plupart des pays occidentaux assistent, sous les effets conjugués de l'exode rural, de la mécanisation massive de l'agriculture et du remembrement, à la disparition des sociétés paysannes. Advenue en seulement quelques décennies, cette rupture fondamentale avec des structures sociales qui existaient depuis un millénaire crée un sentiment de vide qui pousse à la production d’œuvres célébrant les communautés rurales traditionnelles. Les historiens s'intéressent ainsi à ce “monde que nous avons perdu” pour reprendre le titre de l'ouvrage de Peter Laslett consacré à la paysannerie anglaise paru en 1965. En France et en Belgique, des bandes dessinées comme Les Schtroumpfs (1958) et Astérix (1959), deux œuvres que l'on peut inscrire dans la fantasy, publiées seulement quelques années après Le seigneur des anneaux, répondent également aux angoisses provoquées par l'urbanisation, l'artificialisation et l'industrialisation en mettant en scène des petites sociétés villageoises et magiques vivant au milieu d'une forêt. Celles-ci tentent de survivre face à un monde globalisant ou terrifiant, incarné soit par les humains dans l’œuvre de Peyo, soit par les Romains dans celle de Goscinny et Uderzo. Dans Le domaine des dieux (1971), le village gaulois où vivent Astérix et Obélix, nouveaux Wolfings, est par exemple confronté à un entrepreneur romain qui souhaite remplacer la forêt alentour par un complexe hôtelier et touristique. Ce récit fait écho aux premiers projets de centres commerciaux dans la campagne proche de Paris, comme Parly 2 ouvert en 1969 à côté de Versailles. La ville modèle pensée par l'architecte Anglaigus n'a en fait que pour but de détruire le mode de vie communautaire et solidaire des villageois en les transformant en petits entrepreneurs, vendeurs de souvenirs pour des touristes venus de la Cité éternelle. Au même moment, Le Hobbit puis Le seigneur des anneaux sont traduits et publiés en France, respectivement en 1969 et 1972-1973."
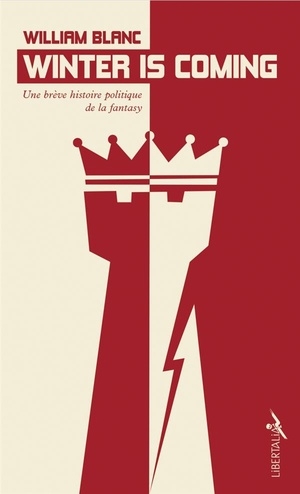
00:00 Publié dans Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
28 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 132
"Le pouvoir nous enseigne à rejeter l’évidence de nos yeux et de nos oreilles. C’est son commandement ultime, le plus essentiel. Winston sentit son cœur lui manquer à la pensée de la puissance démesurée qui était déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n’importe quel intellectuel le remettrait à sa place avec des arguments subtils qu’il serait incapable de comprendre, et plus encore de contrer.
Et pourtant, il avait raison ! Ils avaient tort, il avait raison. Il fallait défendre les évidences, les platitudes, les vérités. Les truismes sont vrais, accrochons-nous à cela ! Le monde physique existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l’eau est liquide, tout objet lâché est attiré par le centre de la terre.
Avec le sentiment de s’adresser à O’Brien, et aussi d’énoncer un axiome important, Winston écrivit : La liberté est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Si cela est accordé, tout le reste suit."
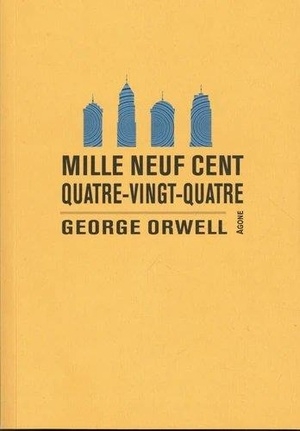
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
27 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 131
"Nous transmettrons le contenu des livres à nos enfants, oralement, et nos enfants, à leur tour, apporteront leur enseignement aux autres. Beaucoup seront perdus, c’est inévitable. Mais on ne peut forcer les gens à écouter. Il faut qu’ils viennent à nous, chacun à son heure, se demandant ce qui s’est passé et pourquoi le monde a explosé sous leurs pieds."
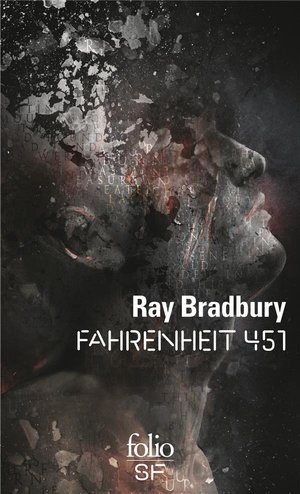
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
26 janvier 2023
"BOUQUINAGE" - 130
"Quel sel ont la vérité et la beauté quand les bombes à anthrax éclatent tout autour de vous ? C’est alors que la science commença à être tenue en bride, après la Guerre de Neuf Ans. A ce moment-là, les gens étaient disposés à ce qu’on tînt en bride jusqu’à leur appétit. N’importe quoi, pourvu qu’on pût vivre tranquille. Nous avons continué, dès lors, à tenir la bride. Cela n’a pas été une fort bonne chose pour la vérité, bien entendu. Mais ça a été excellent pour le bonheur."
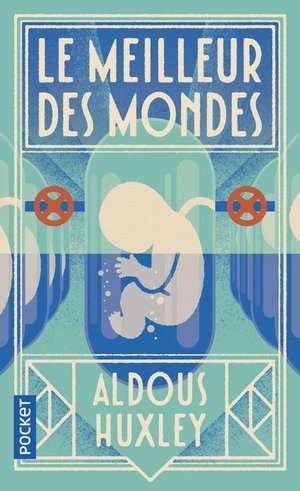
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |


































